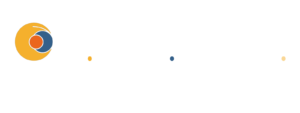De Jean-Claude Bourdet, édité par Jean-Claude Tardif dans la collection Les Plaquettes, À L’INDEX, Hors-série- ;
Librairie Olympique, Marché de la Poésie, Bordeaux, printemps 2021.
L’Inédite Edition Escale du Livre – Bordeaux Printemps 2021
Viennent aux signes/ les ombres torturées. / Je pense au jour où les chevaux ont appris à pleurer. Antonio Gamoneda
Les origines.
Le temps a-t-il de l’importance ?
Depuis plus d’une année nous vivons dans une incertitude insistante de l’avenir en raison de facteurs sanitaires, écologiques, économiques et sociaux, donc politiques. C’est une période qui pour certains a été propice à l’écriture.
Pour moi l’écriture a des origines infantiles indissociables du temps qui passe.
C’est ma mère qui m’a appris à écrire dans un petit village du nord de la Dordogne.
Temps longtemps resté en suspens, sorte de paradis perdu d’une enfance idéalisée. Figée dans un écran de télé carré, d’où surgissait tous les soirs, dès les années soixante, les personnages d’un monde imaginaire clos. Une phrase revenait en boucle, elle déclenchait une vague émotionnelle retenue, « le marchand de sable est passé ! Au lit » !
Il faut bien une origine, : les garçons naissaient dans des choux et les filles dans des roses.
Puis le temps a passé, comme disaient les anciens, de l’eau a coulé sous les ponts.
C’est cela pour moi le temps, c’est le temps de la narration.
Je vous raconte une histoire et le temps s’organise, il y a un avant, un maintenant et il y aura un après.
C’est le temps de la ruralité qui m’a structuré, on voit le clocher du champ qu’on cultive, tout le monde connait les enfants des instituteurs, il y a les copains avec qui je joue et les autres, il y a la fille de la forge que je sauve des flammes infernales et les bagarres dans la cour de récréation.
Il y a, pour moi, une continuité temporelle et topographique entre le temps de l’apprentissage, qui nécessite de passer une porte latérale, et le temps familial, ils coexistent en contiguïté. Lorsque le marchand de sable est passé, nous nous engouffrons dans un couloir glacial, nous montons quatre à quatre un escalier grinçant pour nous jeter sur les matelas chauffés par le petit poêle à bois.
Là c’est le domaine des contes et des rêves. C’est aussi une île isolée, entourée de récifs qui protège des tempêtes ; de la chambre des parents ; des peurs, des craquements sinistres et du terrible grenier envahi par les souris, la « mort aux rats » dangereuse et le froid glacial de la NUIT.
Et la poésie ? Tu as toujours écrit des poèmes ?
La poésie, pour moi vient d’une lointaine époque, l’école primaire.
Elle était alors réservée aux cahiers, ils avaient des carreaux alignés, elle était associée à des phrases rituelles, entendues le soir : « Il faut apprendre ta poésie » et : « récite ton poème ! »
Elle était assez esthétisante, écrite en élégante cursive, avec un porteplume trempé dans un encrier carré en verre et séchée avec un buvard bleu ciel ou rose, il y avait souvent des illustrations, des dessins d’artiste ou des photos animalières ou de paysages.
Ma mère m’a expliqué comment elle faisait travailler la poésie. Elle proposait un thème lié à l’actualité, à un événement aux saisons puis elle demandait à ses élèves de Cours élémentaire d’effectuer des listes de mots enfin chacun écrivait une poésie selon son inspiration. Mais la plupart du temps il était difficile de relire les textes alors elle écrivait le poème de chaque enfant au tableau noir, ou sur de grandes feuilles blanches. À l’étonnement d’un inspecteur qui lui faisait remarquer l’énergie qu’elle déployait dans cette transcription elle répondait que le travail des enfants valait bien cet effort et rajoutait qu’ainsi elle donnait une valeur à la créativité poétique des élèves.
Ce poème est le fruit d’un long cheminement comme tu vois !
Tu écris depuis longtemps alors, as-tu déjà été édité ou publié ?
J’ai toujours écrit des poèmes sans jamais chercher à les publier, mais dans les années 2008-2010 j’ai eu une période personnelle difficile, l’écriture s’est présentée, je m’en suis saisi.
J’ai écrit, des nouvelles, des poèmes (dont un travail sur le regard), des chansons, j’ai participé à des concours.
J’ai ainsi fait de belles rencontres, toi et la Librairie Olympique, Gabriel Mwéné Okoundji au Marché de la poésie des chartons, Gilles Jallet a été présent aussi à cette période.
Mais cette veine c’est tari sans que l’édition que j’avais sollicité alors ne relève le défi.
Le temps est passé, ma vie s’est apaisée, réorganisée, l’écriture est restée mais orientée vers des productions plus techniques en lien avec mes activités professionnelles, notes, mémoires, comptes-rendus, séminaires.
Puis j’ai commencé à réunir certains textes qui sont devenus un livre qui devrait sortir prochainement chez Az’art atelier d’édition à Toulouse. Il s’agit d’un récit fictionnel et autofictionnel centré sur deux personnages, un psychanalyste et son ami Pierre, c’est un récit étrange, improbable, en prose, avec de la poésie et du théâtre. J’aurais certainement l’occasion de t’en reparler à sa sortie.
J’ai rencontré Sylvie Basteau lors d’un dîner dans le cadre d’un colloque, son conjoint est un confrère.
Gabriel et Sylvie avaient un projet de livre, la poésie était de retour.
Je lui ai prêté un livre du poète Antonio Gamoneda « Passion du regard » et le chemin a commencé.
Jean-Claude Tardif a accueilli un extrait du poème dans la revue qu’il anime, À L’INDEX et, plus tard, m’a fait l’honneur de publier ce recueil, avec le beau liminaire de Gilles Jallet et les trois œuvres de Sylvie Basteau, dans la collection Les Plaquettes.
Jean-Claude Tardif est un auteur et un poète très engagé dans l’édition et l’animation de revue poétique, c’est très précieux de rencontrer des personnages de son niveau.
Dans l’entre-temps j’écris, un de ses derniers recueils explore l’espace-temps qui relie les mots et le silence des mots.
Dans l’interstice des mots, il est encore des mots. (JC. Tardif, Dans l’entre-temps j’écris, Les Plaquettes, A L’index)
J’ai découvert un florilège d’auteurs qu’il publie dans A L’index ou dans deux collections très abouties, celle qui m’a publié, Les plaquettes et « Le tire langue » qui est une très belle collection qui publie des éditions bilingues d’auteurs étrangers.
J’ai été très touché par un auteur Américain, méconnu, Robert Nash, dont il a été publié deux livres dans cette collection, « Maine » et « Poèmes à un ami français ». Le deuxième livre est un long texte mélancolique sur la perte d’êtres chers, c’est écrit dans un langage simple, avec des mots de tous les jours qui donnent une force bouleversante au texte qui s’adresse à un lointain ami.
Surprise ! / J’ai cueilli du miel sauvage / Le dernier de l’année / les abeilles s’endorment déjà / La forêt est rousse. / Demain la lune, couleur de sang séché, / accentuera les ombres. / Il fera grand calme entre les troncs / les animaux eux-mêmes / resteront à couvert. / J’ai rentré du bois pour le feu / / Je ne sais pas bien pourquoi. (R. Nash, Poème à un ami français, Le tire langue, A L’INDEX)
Il y a de nombreuses références à des lieux dans ton poème est-ce habituel dans ta façon d’écrire ?
Oui, je suis façonné comme nous tous je crois, par la géographie de notre enfance et ensuite par les voyages que nous avons fait, en réalité comme en rêve.
J’ai fait mes premiers pas dans le Lot et le nord de la Dordogne, un pays très contrasté, j’aime l’ombrage des forêt de châtaigner, la lumière crue du causse. Je parle régulièrement du lieu où vivent mes parents et mes amis, dans la plaine de Pinsac, où nous avons quelques ruches.
Je n’ai pas de souvenir du Maroc où je suis né. Ensuite les plages de l’océan Atlantique et la vallée de la Dordogne ont rythmé les saisons. J’ai peu voyagé, mais certains pays m’ont profondément marqué, le Maroc bien-sûr, j’y ai fait un pèlerinage dans les années 2000, sur la colline des potiers et dans le port de Safi. Mais aussi l’Afrique noire, le Bénin, le Sénégal ; l’Europe qui est une source inépuisable de nourriture culturelle ; l’Amérique du Nord, mon frère vit au Québec, New-York bien-sûr ; je ne connais pas l’Asie ni le continent Indien que connait bien Sylvie.
Le poème
Et la genèse du poème ?
Octobre 2018, extrait :
terre sauvage, les ailes du vent dessinent / non coupent l’espace / en toiles aigues mouvantes / des coups des coups de couleurs des coups du vent des coups de pinceau /
bewegung / mouvement / déplacement
Mouvement associatif, légère écriture automatique qui entraine inévitablement sur une pente que ponctue une hésitation.
Je crois que cette hésitation est un des mécanismes qui me font m’adresser directement à la peintre dans le poème ou à l’autre dans l’écriture.
Tu peux préciser ce que tu entends par là ?
L’hésitation est un temps de suspension, un entre-deux dans lequel tout peut arriver, l’inspiration come la chute alors je crois que cela plonge ma psyché dans une sorte d’insécurité qui m’oblige à parcourir la surface des tableaux avecleurs reliefs.
Sylvie utilise depuis très longtemps une technique mixte dont elle parle très bien dans le film qui la montre dans son atelier.
C’est une vision syncrétique plus que symbolique ou narrative qui s’exprime le plus souvent en premier lieu, mais en relisant les premiers jets du poème j’ai été surpris par leur aspect très narratif, je semble hésiter entre le récit, la prose et le vers qui vient plus tard. Je le travaille avec beaucoup de précision tu sais.
Ta technique mixte, acrylique et papier précieux, crée la sensation cénesthésique d’un espace instable, incertain, nécessitant une accroche, historique, métaphorique, sensorielle, culturelle ou intellectuelle.
Le profond du regard de la peintre m’introduit paradoxalement à une surface mais aussi plus logiquement à un volume, à un espace tridimensionnel et à ce que j’appelle désormais au temps singulier du colibri ou de l’abeille. Le vol stationnaire.
Le regard de la peintre est une métaphore de la connaissance, une figure sublimée de mon rapport à l’art et à la création, il est « pro », « avant ». J’ai découvert en rédigeant cette discussion deux ans après avoir commencé l’écriture du poème les citations étonnantes du CNRTL au sujet de l’étymologie du mot profond.
Qui pénètre très en avant (Guillaume Tardif, art de la faulconnerie et des chiens de chasse, 1492) ; Qui pénètre fort avant dans la connaissance des choses (1636, Monet)
Le travail de la peintre précède le sens, son regard est avant le geste, son travail est à la fois avant le froid, avant le chaud, avant le vide, avant le plein.
La peintre est la force qui pousse la vie à vivre.
La pulsion freudienne. Et une des figures du Destin, j’aime penser qu’elle est Lachésis la réparatrice, qui a le pouvoir de changer le destin, c’est une des trois Moires (les Parques dans la mythologie romaine), avec Clotho, la fileuse et Atropos, l’inflexible.
« Tu es à la fois l’origine et la fin.
Le faucon, oiseau sacré d’une aube de l’humanité. »
Gilles Jallet écrit dans son beau liminaire : « L’approche poétique de Jean-Claude Bourdet ― d’autant plus surprenante si l’on songe qu’il exerce au jour le jour le métier de psychiatre et de psychanalyste, dont la pratique de l’écriture est remplie de comptes rendus de consultation, de fiches d’évaluation et de mémoire clinique ― ne décrit pas le tableau, ne tente pas de l’interpréter dans une sorte de savoir constitué ou même en acte, ne cherche pas à le reproduire, mais « se rêve » elle-même sur le modèle de la peinture. »
Ce que Gilles a écrit au sujet du poème m’a fait penser à un texte d’un autre auteur, JB Pontalis. Il s’agit d’une nouvelle le Dormeur éveillé, inspirée d’un tableau de Piero Della Francesca (1422-1492), Le songe de Constantin. Pontalis écrit :« À côté de l’homme qui dort, un tout jeune homme assis. (…) Il est le dormeur éveillé. » Pontalis était psychanalyste, il s’agit certainement pour lui d’une métaphore pour esquisser une des figures du psychanalyste.
J’ai imaginé être cet homme, endormi-éveillé, qui écoute les tableaux ; celui dont les pensées, les images qui lui viennent sont en résonance avec la peinture. Je me retrouve à cette place du psychanalyste-poète, au cœur de la fabrique des mots, à l’endroit où se situe le « muet dans la langue », pour reprendre le titre d’un livre d’un autre psychanalyste Edmundo Gómez Mango. Celui qui écoute, en silence la langue infantile, le psychanalyste qui effectue ses constructions interprétatives et le Dichter celui qui traduit la langue en poème.
Ce poème n’est pas seulement une rêverie que les tableaux de Sylvie m’auraient inspirée. C’est beaucoup plus complexe je crois.
J’ai envie, pour préciser les choses, de dire qu’il s’agit plutôt d’un songe dans le sens que lui donne Sylvie Germain, citée par J.B. Pontalis :
Ses racines (du songe) ne s’enroulaient pas seulement dans l’obscur terreau de notre inconscient, mais s’enfonçait bien en deçà, s’élançaient bien au-delà.
Pro- fondeur qui s’étaye sur le poème de Denis Clavel toujours cité par J.B. Pontalis :
Un jour je vous dirai la différence entre le songe et le rêve / L’épluchure de l’esprit c’est le rêve / même si le fruit est parfait il y a des restes / Le songe est parole pour l’âme / même si la parole est imparfaite il y a le chant.
D’une certaine façon, la peinture était déjà là, c’est comme si je n’avais pas eu besoin de la faire mienne. Je voyais les toiles défiler et les mots/vers trouvaient leur forme. Pas immédiatement mais comme s’il n’avait fallu que me pencher avec une outre et la plonger dans l’eau vive d’un fleuve.
L’arborescence poétique à croisé ce qui était là, matière éprouvée mais aussi conscience d’une fin : « la contemplation de mes actes au miroir de la mort » écrit Antonio Gamoneda dans Clarté sans repos.
Antonio Gamoneda est « La silhouette frêle d’homme debout » du début du poème. Ce poète d’origine espagnole a été très important pour moi lors de mon précédent travail sur le regard, il a écrit « Passion du regard », un recueil traduit de l’espagnol par Jacques Ancet, paru chez Lettres vives. Il a aussi théorisé ce qu’est la poésie pour lui, « la création d’objets d’art dont la matière est le langage ». Art du temps et d’une mémoire sensible.
Je me suis longtemps reconnu dans cette approche même si la fréquentation d’autres courants fait évoluer ma réflexion.
J’en suis un interprète, je dessine un sens et ma responsabilité c’est de trouver le juste mot, la métaphore nécessaire qui va faire vivre le tableau, le faire résonner chez le lecteur.
La narration m’aide à écrire elle est après l’âpreté de la descente des pentes arides des énoncés des associations des images-mots images-sons, un passage obligé, lorsque je relis les premières versions, écrites parfois d’un trait, je vois qu’elles contiennent une genèse du poème qui est encore balbutiement, ensuite il prend une forme qui, à un moment se solidifie. J’ai souvent pensé, en discutant avec ma sœur qui est sculptrice, que je sculptais les mots.
Les vers « s’inalignent », épars au début, ils s’assemblent ensuite comme les enfants dans le poème de Tagore :
Sur le rivage des mondes infinis, des enfants s’assemblent. La tempête erre dans le ciel sans routes, les navires sombrent dans la mer sans sillages, la mort rôde et les enfants jouent. Sur le rivage des mondes infinis se tient la grande assemblée des enfants. (Rabindranath Tagore, L’offrande lyrique, nrf, Poésie, Gallimard)
Ou -bien, comme les mots lorsqu’ils se préparent pour une bataille (Churchill).
Les mots sont comme la grande foule des enfants, ils s’assemblent, ils peuvent aussi être une armée qui se déplace.
On croit qu’ils arrivent de nulle part, en fait ils sont là plupart du temps déjà là.
Dans un inconscient, liés à des images, a des émotions réprimées, à des affects et des représentations refoulées.
Sensations, impressions, méconnues, mystérieuses, attendent leur déploiement en comportement en somatisations ou en discours.
La mort est très présente dans le poème, sous différentes formes, Gamoneda en a fait un pivot théorique de son rapport au poème mais ce n’est qu’à la relecture de mon poème qu’il m’est apparu qu’elle était là en filigrane du texte. Elle est présente dans le poème sous différentes formes, fantômes, disparus, ancêtres, personnages illustres ou inconnus, comme Ndzama, mais je crois que mon poème colonise aussi les œuvres de Sylvie avec des personnages issus de mes souvenirs, de mes références culturelles ou personnelles.
Peux-tu nous parler de ta vision des poèmes du recueil ?
Le poète s’adresse à la figure de la peintre qui devient véhicule de ma recherche sur l’essence de la créativité.
J’ai marché sur les pas de tes voyages, dans les couleurs et les humeurs vagabondes et sinueuses de tes Envols.
Ces chemins ont croisé mes obsessions et mes passions, mes voyages intérieurs, culturels et géographiques. Je me suis égaré en dehors de ta peinture pour écrire En chemin, j’ai retrouvé certaines douleurs. Je me suis éloigné de Savane pour parcourir des vallées corses, des plages oléronaises, des souvenirs d’enfance qui m’ont conduits vers la poésie et la psychanalyse.
Le confinement est aussi passé par là et dans jour après jour j’ai tenté une aventure métaphysique en apesanteur poétique tout en restant bien ancré sur le réel des évènements et des souvenirs. C’est une tentative d’écriture des origines familiales lotoises comme parabole universelle de la souffrance et de la finitude de l’homme.
Eclats apparait comme une suspension du temps, dans ce poème je retrouve le rythme de la peinture, ses couleurs, sa musique.
Juste après, en écoutant une émission de France Culture j’ai surfé les mots sur une vague émotionnelle accompagnée d’une contrebasse satanique avant d’enlacer Danse avec la lune dans une dernière valse syncopée. Dans ces deux mouvements d’écriture j’ai tout à fait conscience d’avoir été dans la projection ou l’imagination tente de recréer la réalité émotionnelle sans avoir aucunement besoin de s’en méfier.
En écrivant cela je prends conscience d’une certaine liberté dans l’écriture, liberté que m’a fait remarquer Gilles Jallet dans une de nos récentes discussions.
J’aime, depuis que j’écris de la poésie, utiliser des mots qui ne me sont pas familiers, je considère que le poème est aussi l’occasion de découvrir la langue, la culture, cela n’est pas toujours simple mais j’y tiens. C’est en contradiction avec d’autres attentes, par exemple d’exprimer simplement ce que je souhaite transmettre mais cela fait partie des contradictions et des paradoxes communs je crois.
J’ai déjà écrit au sujet de peintres ou d’œuvres, des poèmes, des réflexions, des pensées. Dans mon travail sur le regard j’ai écrit sur certaines œuvres de Yves Klein ou de Gustave Courbet, j’ai été fasciné par une série de tableaux de Courbet, vus lors d’une exposition à Paris.
« Courbet, dans quelle peinture, est-tu ?
Cerf agonisant, nu sensuel,
Autoportrait déformé, halluciné,
Dans cette source verte aux corps assoupis
Dans quel abîme au vertige insondable
Cache-tu l’intimité obscène de ton cœur ?
Enflammé, provocateur, les hommes
Solitaires que tu immortalises m’on converti.
L’alcôve de « l’origine » côtoie un paysage
Terre de Sienne aux collines érotiques.
La vision profonde fige l’être entier
Soleil rouge
Tristes reflets.
Les vagues suspendues
En fracas trempé
Dispensent des pensées délirantes
Etrangères
Aux murmures de la foule alanguie. »
JC Bourdet Février 2008, extrait de Regards, relu en Mars 2021, laissé tel-quel.
Le travail
Comment le poète et le psychanalyste se conjuguent -ils dans ton travail ?
Le poète comme le psychanalyste sont de ceux qui, en se laissant imprégner de la présence de l’autre, ont la responsabilité d’en traduire la langue inconsciente.
Je m’inscris, je crois en disant cela dans une poésie de la sensibilité, une poésie impressionniste qui n’a pas très bonne presse, j’en suis conscient.
J’ai travaillé, pour un séminaire, sur la peinture de Paul Klee.
Le peintre mélomane était atteint de sclérodermie, une maladie très grave à évolution inéluctable qui a pour conséquence une sorte de transformation de la peau qui se parchemine. C’est une véritable affliction avec des périodes de crise douloureuse car tous les tissus peuvent être atteint.
Toute son œuvre est un combat et il utilise les ressources intellectuelles, émotionnelles, affectives qu’il lui est donné de posséder dans l’exercice de son art. J’avais remarqué combien la confusion, la disparition des limites entre le moi et le ça était susceptibles de précipiter une décompensation, la peinture en était le plus souvent affectée. Suites de tremblements, les personnages filaires, les corps morcelés, les enveloppes effractées s’agitaient dans une danse macabre que quelques répits soulageaient, les voyages en Tunisie étaient alors l’occasion de peintures colorées, chaleureuses.
La figure du grammairien soutenue par Zukofsky et Hocquard ne m’est pas inconnue car elle rejoint la figure du clinicien et du psychanalyste apathique. Hocquart écrit dans « La poésie mode d’emploi » que Zukofsky s’appuyait sur les théories de Wittgenstein pour qui c’est la description de l’usage du mot, et non leur nature ou leur signification, qui est important.
Je connais cette approche que nous utilisions, lorsque je travaillais à l’hôpital, dans nos interventions avec des adolescents psychotiques. J’ai participé à un atelier qui leur proposait de créer librement des œuvres, à partir d’objets de récupérations, ils participaient à la collecte des divers objets. Lors d’un temps de parole en fin de séance, les thérapeutes ne proposaient jamais d’interprétation symboliques de la création, ils demandaient simplement comment le jeune avait procédé, quelle colle avait-il utilisé, pourquoi avait-il vissé ou mis du fil de fer etc. L’idée était de créer un environnement apaisé, sans excitation excessive, la parcimonie de l’usage du langage contrastait souvent avec la richesse de la création, l’inventivité ou la bizarrerie de l’objet crée, parfois naïf, parfois sexualisé, violent, voire menaçant, d’autre fois sans forme définissable. Nous utilisions le même procédé en atelier d’écriture avec d’autres adolescents intéressés par ce média, nous n’interprétions jamais le sens du texte, nous laissions au jeune la liberté de s’exprimer ou pas, nous modérions cependant les commentaires des autres adolescents en prenant soin de respecter la création quelle qu’en soit la qualité ou la forme, ils étaient parfois brillants, avec une aisance dans l’écriture que j’enviais, d’autre fois l’écriture était laborieuse et pauvre.
Pour Emmanuel Hocquard : « la pratique et l’expérience poétique naît de la simple contemplation des fragments (de la table de Montalban) … et les connexions nouvelles qui peuvent s’établir entre eux. »
La « table » sur laquelle je fabrique ma réalité poétique procède de cet effacement tricoté entre la trace et la forme.
Littéralité / Tautologie / Mot / Dictionnaire / Privé / Conscient / Préconscient / Inconscient, tissent une pure dentelle, enlacés avec, Eros et Thanatos, dans une étreinte intemporelle.
« Sur le chemin…
elle est partie
seule, s’est perdue
une journée à chercher sa route
là, elle
serpente le long des flancs
vallée d’Ossau ou bien d’Arreau ? »
Je reconnais là un extrait du poème !
Oui, serpenter me convient, me perdre aussi dans la langue, dans la forêt des mots. J’ai pris le temps nécessaire à la vinification du poème il a été élevé dans des fûts de chêne ou de châtaigniers du Lot et du nord de la Dordogne.
Le psychanalyste, le poète, l’écrivain sont indissociables en moi.
Pas seulement dans un aspect identitaire, mais aussi dans une dimension symbolique, interprétative et intellectuelle.
La prosodie du discours des patients, qui agit par sympathie, par imprégnation, opère une conversion du transfert en récit interprétatif énoncé ou pas lors de la séance.
Comment faites-vous pour ne pas devenir comme les personnes qui vous parlent ? m’avait, un jour dit un patient !
L’être humain est habité par une matrice du verbe qui lie et délie en permanence, sous l’égide de la pulsion, les représentations et les affects en les convertissant parfois en images, parfois en mots, en récit, parfois en actes symboliques ou opératoires.
Une des origines des romans, des mythes, des contes était attribué par Freud, mais aussi par Marthe Robert, à ce qu’il avait nommé le roman familial des névrosés.
C’est la figure du Dichter que j’ai déjà évoqué.
Loin de l’intranquillité de la cure, l’apathie du psychanalyste serait le terrain fertile du verbe. Le poète a la responsabilité de révéler plus que d’interpréter la figure du peintre au travail. C’est ce qui me surprend lorsque l’écriture poétique se présente elle est très éloignée du récit qui peut se déployer en second. La proximité de mots-métaphores, de mots-images, domine l’expérience de l’écriture qui entre dans une danse plus ou moins syncopée ou langoureuse avec ce « monde qui ne veut rien » honoré par Freud et les poètes en particulier la poésie qualifiée d’objectiviste de Charles Reznikoff ou de zukofsky.
« La poésie présente l’objet afin de susciter la sensation. Elle doit être très précise sur l’objet et réticente sur l’émotion » avait l’habitude de dire Charles Reznikoff.
Je rajouterais que le psychanalyste D.W. Winnicott disait que l’objet était présenté par l’environnement, le sujet s’en saisissait dans un espace nommé potentiel, lieu de l’objet-trouvé-crée qui est l’origine même de la créativité. C’est le doudou de l’infans, le rêve de l’adulte ou son poème.
L’exploration des objectivistes m’introduit à une autre ouverture sur l’écriture poétique car ils montrent très bien que « le monde ne veut rien », ils en font même une œuvre très expressive voire esthétisante.
Reznikoff est peut-être plus proche de ma culture, un livre comme Holocauste dégage une puissance qui transcende le récit de la Shoa.
Être poète.
L’engagement poétique dans la vie est déterminant, je crois que je suis en train de tenter de définir ce que cela représente pour moi, j’e n’en suis qu’au début. Les lectures sont toujours une source d’inspiration, de relance de mon écriture.
Je ne partage pas l’aspect radical de la poésie des objectivistes car je le trouve excessif.
Du point de vue du clinicien je dirais que leur écriture est marquée par une dominante de pensée opératoire, factuelle, c’est un reste de masochisme mortifère très éloigné de la vitalité autodestructrice mais flamboyante d’un Apollinaire, d’un Baudelaire par exemple.
Je me suis toujours sentit plus proches de ces poètes de mon adolescence.
Paul Éluard par exemple m’a été très familier à une certaine époque de ma vie.
Il a fonctionné pour moi comme un héros romantique, résistant, communiste, poète, il représentait mon idéal de jeunesse, mes rêves de militant. Je me suis certainement identifié, à cette époque à ses histoires amoureuses désastreuses, Gala qui le quitte pour Dali, figure d’un art assimilé au Franquisme et aux grands argentiers honnis de cette période de ma vie, Nusch qui meurt trop tôt.
Le Dur Désir de durer est resté un emblème secret dans ma construction identitaire, élément des Derniers poèmes d’amour, Dit de la force de l’amour est un des rares poèmes que j’ai appris par chœur.
Le soleil dur comme une pierre / Raison compacte vigne fauve / Et l’espace cruel est un mur qui m’enserre / Dans le désert qui m’habitait qui m’habillait / Elle m’embrassa et en m’embrassant / Elle m’ordonne de voir et d’entendre. / Par des baisers et des paroles / Sa bouche suivi le chemin de ses yeux / Il y eut des vivants des morts et des vivants. Paul Eluard.
Paul Eluard est un des poètes chez qui la force des images m’a tout de suite conquise, j’ai, dans un travail sur la douleur étudié la « Capitale de la douleur »[1] que Paul Eluard a élu, pour un temps, comme lieu de sa pensée.
Qu’en est-il de l’ombre… Une ombre… Toute l’infortune du monde. Et mon amour dessus. Comme une bête nue. Ou encore : Et l’ombre qui descend des fenêtres profondes. Epargne chaque soir le cœur noir de mes yeux…. L’ombre aux soupirs…
« La douleur est chez Eluard un point de fuite, un insaisissable objet qui chapeaute le recueil sans jamais se dévoiler tout au long des poèmes. Les courts textes s’égrènent les uns après les autres sur un ton léger, seule la référence à l’ombre vient projeter en négatif une plainte qui ne se révèle pas. Nous sommes dans le doute, l’énigme de l’absence, à la recherche du signifiant qui reste masqué par la subtilité du propos. Le poète semble agir comme les adolescents qui dénient la souffrance pour mieux s’en approprier l’origine. Se scarifier pour ne pas ressentir la perte douloureuse de l’enfance ? Le registre de la souffrance est, pour Eluard, intimement lié à la perte, à la rupture sentimentale qu’il vit lorsqu’il écrit ces poèmes adressés à Gala, sa femme, qui vient de le quitter pour Dali et plus tard au décès de Nusch, sa femme. » (JC Bourdet, dans le champ de la pensée et du songe le pommier rouge, Az’art Atelier Edition, 2021)
La découverte de Mallarmé a été importante pour mon écriture. La physique de l’absence qu’il utilise dans la forme qu’il donne à certains poèmes a libéré l’écriture poétique d’un certain carcan sans renoncer aux formes classiques, du sonnet, par exemple. En s’affranchissant des formes classiques de la versification il ouvre la voie aux surréalistes qui l’on fait exploser avec violence.
Stéphane Mallarmé était un homme simple, professeur d’anglais, il a enseigné en province et à Paris sur la fin de sa carrière. (Albert Thibaudet, La poésie de Stéphane Mallarmé. Etude littéraire, 1926/2014)
Si je retiens un enseignement des études sur son travail c’est le consensus qu’il semble se dégager et dans lequel je me retrouve aussi d’une certaine façon : il pense avec des images plus qu’avec des idées et avec des mots plus qu’avec des phrases.
Victor Hugo, accueillait Mallarmé, dans son salon littéraire, en l’apostrophant « mon cher poète impressionniste ». « Mallarmé est un poète d’impressions neuves, aigues, difficiles à formuler, discontinues. » Ecrit Alain Thibaudet.
Avec L’après midi d’un Faune, Stéphane Mallarmé, non seulement ouvre la voie du paradigme symboliste comme « art musical de la suggestion » il est aussi à l’origine de la création du premier livre d’artiste inaugurant le dialogue entre un poète Mallarmé et un peintre Manet, qui illustre le livre paru en 1876 chez l’éditeur Derenne à Paris.
En préparant cet entretien, j’ai débuté l’exploration des origines du groupe de La pléiade, c’est passionnant de vitalité, de jeunesse flamboyante. Le combat de ces jeunes poètes, ils avaient entre 16/17 et 25 ans au plus fort de leur créativité, pour sortir du carcans qu’imposait depuis longtemps l’usage du latin est exemplaire de l’engagement du poète dans la défense de la langue française. Et tout cela sous la forme de poèmes et de textes théoriques qui se sont imposés dans toute l’Europe du XVIe siècle jusqu’à ce que le Classicisme les recouvre c’est la période romantique qui les remets à l’honneur grâce à Sainte-Beuve. (J. Charpentreau, Dictionnaire de la poésie française, Fayard)
La peinture.
Comment as-tu rencontré la peinture ? Quel sont les liens entre peinture et poésie dans ton parcours ?
Mes parents ont eu une période « peinture », mon père transportait son chevalet et allait au motif, comme il était dit.
Il reste, accrochés dans la grande maison du Lot, quelques tableaux représentant des paysages, essentiellement, de l’enfance, la Dordogne, les marais de l’île d’Oléron, ma mère a peint des arbres, un groupe de bouleaux que j’ai toujours trouvés un peu seuls au milieu des grands murs aux papiers peints défraichis. Les tableaux ont ainsi toujours été accrochés aux murs, dans des musés ou sur de beaux livres dans ma bibliothèque.
Comme toute ma génération j’ai découvert les peintres du XIX e et du début du XX e, j’ai eu une passion pour Picasso, je crois que sa peinture a très tôt atteint une par profonde de mon être, une part qui aurait pu rester muette si je n’y avais pas associé les mots dans mes analyses personnelles et dans mon travail avec des enfants psychotiques.
C’est cette familiarité, culturelle et intellectuelle avec toute une génération, qui a, je crois maintenant, en partie soutenu mon engagement dans l’écriture de ce poème. Je sais bien que les études, le savoir, la formation comme l’analyse peuvent, comme l’écrit Michel Gribinski être une sorte de « post éducation », mais le dialogue entre les origines et l’actuel constitue un invariant universel pour moi. On sait bien que les tissus trainés derrière les pas des chevaux n’enlèvent pas toute les traces de leur passage, un bon pisteur peut en reconstituer le cheminement.
Il en est ainsi du travail d’expression quel que soit le média utilisé, il laisse des traces que j’essaie de retrouver ou de reconstituer, comme le fait le psychanalyste lorsqu’il effectue une construction dans une cure pour en interpréter un sens à un moment donné.
Mon premier travail sérieux a été sur le regard et mon premier travail publié est sur la peinture plus que sur une peintre, Sylvie Basteau.
Le travail d’écriture porte sur ce que représente la peinture pour moi je crois, sur le symbole qu’est la peinture actuellement. Ou le vestige qu’elle représente dans un monde qui survalorise l’action, l’éphémère et l’image sans oublier le virtuel. C’est d’ailleurs étonnant qu’il y ait tant de tableaux dans des coffres, dans des musées et pas chez les particuliers, chez les citoyens, la peinture est devenue au XX e siècle un placement pour milliardaires, alors que la population doit se contenter de la voir derrière des vitres blindées dans des musées. Etonnant que cette injustice cette privation de l’art, de l’authenticité de l’art ne soit pas plus critiquée plus questionnée ?
Les mots accompagnent l’action, le langage est un système sauvage bien qu’il soit régi par des lois, par une grammaire, une syntaxe, la linguistique en étudie la forme et le sens, la texture du langage. Mais au sein même de ce bel ordonnancement il y a du sauvage, les psychanalystes y entrevoient un inconscient qui « reste maitre du logis ». Mais si on pousse la recherche, c’est peut-être sur le mot, en tant que navire porteur de sa propre langue, qu’on risque de s’échouer. Le mot est la pierre angulaire de l’idée transportée par le poème. Il est une brique qui sert à déterminer la forme et le fond du poème. Le mot ne transporte pas que des lettres assemblées, reliées entre elles, il est le véhicule d’une émotion, que certains tentent de réprimer, il est le vecteur d’un sens que le poète, s’il a de la chance, découvre dans son poème.
Le Colibris ne devrait pas pouvoir voler dit-on, son vol défie les lois de l’apesanteur, pourtant sa grâce nous a tous ému ou intrigué un matin d’été. Il peut battre ses ailes, qu’il actionne jusqu’à 200 fois par seconde, autant de haut en bas que de bas en haut, il est ainsi le seul oiseau à pouvoir reculer. Le Colibris est devenu le symbole du temps, de la fertilité. Il est un totem puissant qui passe d’une torpeur proche de la mort à une vitalité impressionnante qui en fait un symbole de résurrection et il est considéré comme un guérisseur dans certaines cultures amérindiennes. Je crois concevoir la poésie comme le Colibris, parfois en sommeil, parfois jaillissante elle se déverse sur les lignes de la page blanche.
Je tente certainement de conjuguer, dans mon écriture une recherche esthétique à une transmission de sens au plus près du réel, au plus près de l’impression qui est à l’origine du poème. L’envol de l’abeille, le défi colibri, le rythme cadencé de la respiration du marcheur, le souffle ténu de l’agonisant.
La référence de Mallarmé qui réussit dans L’après-midi d’un Faune à créer, grâce au Syrinx, la flute du Dieu Pan, la « sommation musicale des corps des nymphes en écho du néant » est une asymptote directrice.
Les écrits sur la peinture sont innombrables, les Méditations de François Cheng m’ont marquées car c’est un homme qui me semble avoir sans cesse tenu une crête dans sa recherche poétique, graphique et littéraire, un fil comme ces fils de vie qui permettent au plongeur dans les gouffres du Lot de revenir à la surface en suivant ce fil à rebours après la descente.
J’ai découvert plus récemment les écrits de André Du Bouchet sur la peinture j’ai envie d’en citer un extrait si tu veux bien :
C’est à la page 89 d’Ici en deux, peinture, dans la version de la NRF, Poésie / Gallimard.
elle-même, c’est / la réalité – autre, et qui ne ressemble à rien, que / nous désirons. déjà, dans l’embrasure, elle fleurit. / dans le halo d’une floraison au ras, qui perce à travers toute / apparence. / presque sans émoi.
Une remarque déjà sur la construction, la forme du poème, l’absence de majuscule qui souligne la banalité, le « sans émoi » du propos qui est manifestement clinique, un extrait de pensée déconnecté de l’affect, c’est très difficile à effectuer, il faut à la plupart des gens une longue expérience, soit de méditation de pleine conscience, soit d’analyse personnelle pour arriver à se placer dans cette posture de méta cognition, d’observateur météorologue de ses pensées. Cette épure du vers « sans émoi », à la Reznikoff « être très précise sur l’objet et réticente sur l’émotion » est un engagement poétique fort !
J’ai choisi cet extrait car il m’éclaire sur le surgissement de l’image, c’est un poème qui, pour moi, montre à la perfection la pensée en œuvre pour le poète : images, mots répression de l’émotion, omniprésente dans les trous, les espaces, les vides, ce sont les traces de la mise de côté de l’émotion, avec le refus de la majuscule qui est un affranchissement des règles de grammaire. Le poète est un rebelle en révolte contre la langue maternelle qu’il déconstruit au miroir de la mort, comme l’écrit Gamoneda, et qu’il réinvente dans toute la grâce poétique du génie qui l’inspire. Lorsque j’écris cela je suis dans une projection imaginaire, j’en suis conscient et je le précise car ce n’est pas une réflexion issue d’une recherche sur l’auteur de Dans la chaleur vacante.
Jean-Marie Pontévia n’affirme pas seulement que la peinture est « irréductible à tout discours » mais que « le discours n’a pas à lui appliquer ses propres catégories » (p.143, La peinture, masque et miroir) lorsqu’il explore la thèse de ce qui se peint c’est le non-dicible, les trous du langage.
Poésie et psychanalyse, poésie contre psychanalyse, poésie avec ou sans psychanalyse ?
Deux faux jumeaux à l’intérieur désormais ?
Le psychanalyste et le poète entament un dialogue onirique, insomniaque voire conflictuel. Une controverse ?
C’est le mot qui est la sauvagerie même. Le mot est le meurtre du langage, sa radicale humeur et son poison mortel.
Je croyais travailler sur le mot, c’est une logique implacable que celle du langage, c’est une sorte d’algorithme qui échappe à son créateur et s’institue en soldatesque d’une langue oubliée.
J’ai appris avec Freud que les représentations de choses précédaient les représentations de mots. Peut-être est-ce pour cela que j’ai commencé à travailler sur le regard, c’est-à-dire ce qu’il convient de concéder à la figure maternelle, d’une certaine façon, la première image sainte.
Ensuite j’arrive logiquement au verbe, au mot, à la lettre même puisque je travaille actuellement à partir de l’alphabet. Sans commune mesure avec l’œuvre musicale du poète Zukofsky cela va de soi !
C’est un travail qui me fait rencontrer la nature. Le désordre de la nature.
La nature végétale est façonnée par l’homme, nous sommes symbiotiques. Ordonné dans le jardins à la française, elle a un sorte de poésie échevelée dans le jardin anglais ou dans la Permaculture.
Je travaille comme ça de façon intuitive associative, en symbiose et en complémentarité avec mon environnement, avec l’objet de mon attention et de ma recherche, en jardinier j’assemble les espèces de poésies, certaines greffes prennent, d’autres non.
C’est donc une poésie expressive, même si l’intention poétique est logique et rationnelle. C’est la notion freudienne de frayage avec la pulsion qui s’appliquerait le mieux à ce que j’essaie de faire.
En neurophysiologie le frayage est le passage de l’excitation d’un neurone à un autre en empruntant une voie déjà utilisée ce qui diminue la résistance à la circulation de l’influx nerveux. Freud utilise cette notion pour expliquer le cheminement de l’excitation sensorielle vers l’activation hallucinatoire et les représentations de choses (les images) et de mots (le discours). Il ne s’agit en aucune façon d’un mécanisme linéaire car il est soumis à chaque étape à la charge conflictuelle que chaque individu négocie tant avec son environnement que son appareil psycho-affectif. Le vecteur de ce mouvement est la pulsion, avec deux grands ensembles de pulsions, les pulsions du moi, liées au narcissisme et à la conservation de l’espèce et les pulsions dites sexuelles liées au jeu complexe entre éros et thanatos.
Prenez le mot : vers.
Le dictionnaire de la poésie française de Jacques Charpentreau, qui est très classique, en trace l’origine latine, le sillon, la ligne, la rangée, un vers est une ligne d’un poème même s’il existe aussi des poèmes en prose. Le vers français classique reste défini par son métrage (le nombre de syllabes) et sa rime. La césure (vers de plus de 8 syllabes), le rythme du vers et de la strophe sont un bel ensemble mis à plat par Mallarmé qui dénonce le dictat « mystérieux de la Rime ». Il ouvre la voie du vers libre qui n’abolit jamais le système les Yeux d’Elsa de Louis Aragon en sont un bel exemplaire.
D’une certaine façon la langue poétique fait sa propre révolution elle abolit les privilèges du règne, établi depuis le moyen âge, de la rime et du mètre au risque de l’arbitraire d’un rythme singulier qui fait appel à la musicalité de la langue du poète.
Cependant, en fonction de la posture que j’adopte, le sens du mot change : si j’ai affaire avec le nom commun ce sera un élément d’un poème ; si c’est la préposition qui m’est utile le mot indique une direction, un sens, mais aussi une date, une époque, un moment qui reste peu précis, « environ » ; si c’est le son qui conquiers mon entendement, le mot devient un petit animal visqueux ou une couleur, il faut alors que j’ai recours à mes connaissances lexicales pour en déchiffrer le sens que l’orthographe va départager (vert).
Je crois qu’en poésie il s’agit de retrouver cet état de confusion qui sous-tend l’hésitation, et se laisser guider par l’inspiration ce qui devient un poème.
Je me sens proche de cet éclat déclaratif d’Alain lorsqu’il écrit : « Le vrai poète est celui qui trouve l’idée en trouvant le vers ». (Alain, Préliminaire à l’esthétique. Cité par l’auteur du dictionnaire)
Le psychanalyste d’origine Uruguayenne Edmundo Gomez Mango a écrit dans un de ses livres : … tous deux (le poète et le psychanalyste) s’abandonnent à l’activité de la langue pour dire ce qu’ils ressentent, pour donner forme à des images ou à des affects, pour raconter leurs souvenirs, leurs rêves ou leurs fantasmes. Le poète et le psychanalyste travaillent au sein même de la poïesis, la fabrique, le faire des mots.
Freud, dans le titre d’un article paru en 1908 a associé la création littéraire et le rêve éveillé dans une quête analytique des origines de la création en littérature.
Plus tard, en 1917, Freud présentera un travail sur l’auto biographie de Goethe Poésie et vérité. Il relate une souvenir d’enfance de Goethe dans lequel il est alors âgé de quatre ans environ, encouragé par son voisinage immédiat, il jubile en lançant par la fenêtre de la cuisine de la maison de ses parents, des jouets et de la vaisselle en terre cuite qui venaient d’être achetés au marché de la poterie. Il ponctue ce souvenir en écrivant : « Le mal était fait (quelqu’un avait mis le holà à son jeu) et en échange de tant de poteries brisées, on avait au moins une histoire amusante, dont surtout les malicieux investigateurs (les trois frères Ochsenstein) se délectèrent jusqu’à la fin de leur vie ». Une histoire était née d’une anecdote singulière. Je pense que c’est une des sources de l’inspiration narrative et poétique, le souvenir d’enfance ou le souvenir relaté par d’autres, déformé, mis en récit de façon intentionnelle.
Freud était un chercheur, après avoir exercé ses talents de scientifique à rechercher les organes génitaux d’une variété d’anguilles, il a disséqué l’âme humaine avec sa technique psychanalytique en espérant peut-être résoudre l’éternelle question : qu’est-ce qui fait que le Dichter réussit à nous émouvoir, à provoquer en nous des émotions ou une réflexion si profonde avec des mots qui composés différemment ne nous atteindraient pas.
En effet le constat que je fais tous les jours c’est que différentes formes de poésie prennent un sens différent en fonction de nombreux paramètres que je tente de définir avec toi.
La musicalité d’une langue par exemple. Il existe des textes qu’il est très plaisant d’entendre chanter, ce qui est, je crois, la forme la plus ancienne de l’expression poétique. L’Illiade a certainement dû être chantée avant d’être simplement lue.
La forme classique du vers est portée par le jeu des acteurs dans le théâtre tragique.
Le poème est porté par le jeu, la rencontre, l’énoncé à voix haute, le chant. Mais aussi par la lecture silencieuse, l’intimité d’un dialogue intérieur entre le lecteur et le poème lorsqu’il devient livre.
Ce qui intriguait le chercheur Freud c’est le surgissement au cours d’une cure de souvenirs d’enfance chargés affectivement, il en théorisa la notion de souvenir écran qui lui permettait de mettre le souvenir au travail. Au départ il utilisa le fond théorique de sa magistrale Die Traumdeutung, L’interprétation des rêves, surtout les chapitres VI et VII dans lesquels il met en évidence le travail de condensation, de déplacement, de symbolisation du rêve mais aussi de présentabilité du rêve, ainsi que les mécanismes de régression, d’oubli, d’accomplissement de souhait, les fonctions du rêve. Ensuite il associa l’œuvre du transfert à la transmission et à l’actualisation du discours de l’analysant complétant ainsi la théorie.
Beaucoup plus tard, vers la fin du XX e siècle, J. – B. Pontalis dans son livre La force d’attraction, en explorant le précaire abri des mots, nous donna une des figures de l’altérité, « de notre étranger intime, qui (dit) la force d’attraction qu’exerce sur nous la chose même, à jamais hors d’atteinte. »
Enfin…
Hier. Gabriel Mwéné Okoundji a laissé un message sur mon WhatsApp, il venait de recevoir des livres de poésie que Jean-Claude Tardif lui avait adressé. Il lisait La peintre le sait-elle ?
Il a laissé sa voix lire la page 23 du texte, puis la page 28 et la page 34 qui évoque le titre du livre.
Je connais bien cette voix grave, trainante, mélodieuse, chaleureuse, je l’ai entendue dire sa poésie à de nombreuses reprises. Mais ce que j’entendais par sa voix c’étaient mes mots et elle leur donnait une direction celle de la vie. Je n’avais pas relu le poème qui rend hommage à Ndzama, je viens de le faire et j’en re découvre tout le sens et la profondeur.
En citant Ndzama je lui témoignais de ma peine pour la perte d’une mère, le travail de l’écriture participe au deuil de la disparue.
Aujourd’hui. J’ai eu Sylvie, la peintre, au téléphone, c’était au sujet de cet échange entre le libraire, le poète-psychanalyste et la peintre. Elle m’a parlé du peintre et graveur japonais Katsushika Hokusai, le peintre de la grande vague de Kanagawa et des Hokusai Manga, estampes en trois couleurs qui croquent des scènes de la vie quotidienne. Il avait pour principe d’être en quête permanente de connaissance, et projetait toujours d’explorer un domaine nouveau à tel âge de sa vie.
Demain. J’ai déjà plusieurs projets en cours, qui sait ce qu’ils deviendront mais je te donne déjà rendez-vous pour la suite.
Hier, j’ai écrit ces quelques mots dans l’après coup d’une journée de travail.
Son cahier perdu dérive/ bateau ivre de liberté/ et ma voix lui donne du courage. / Avec ses mains en coupe/ elle recueille, source fraîche/ la main brûlante de l’infant.
[1] – Paul Eluard : Capitale de la douleur ; NRF, Poésie/Gallimard, 1976