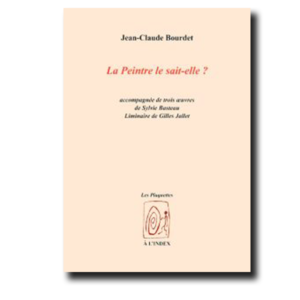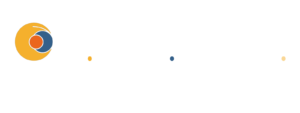Les histoires d’A
Les histoires d’amour
Les histoires d’amour finissent mal
Les histoires d’amour finissent mal en général…
Les Rita Mitsouko.
Ou bien
Il était une fois… Et ils se marièrent … Et eurent une fille…
Un conte.
Conférence donnée le 27 Octobre 2020 dans le cadre de Résurgence IV à Biars-sur-Cère
Les contes.
« Le royaume du conte, en effet, n’est pas autre chose que l’univers familial bien clos et bien délimité où se joue le drame premier de l’homme. » Marthe Robert, Préface de Grimm, Contes, Folio classiques, 1998.
La famille
« La bonne mère est l’Arlésienne du conte. » Ecrivait en 1995 Pierre Laforgue, Pédopsychiatre, Psychanalyste, dans Petit Poucet deviendra grand, Le travail du conte, Mollat éditeur, 1995.
Les contes traditionnels ne parlent pas de la famille réelle, en général ils parlent de la famille intériorisée et des conflits du « drame familial » dans les moments de changement de la composition ou de la structure familiale (naissance d’un enfant, disjonction de la famille, ou drame divers). Il s’agit de moments clefs qui impliquent la plupart du temps le passage d’une génération à l’autre.
Conte et rêve
Dans les contes il est communément considéré qu’on est psychologiquement dans le registre du rêve au sens freudien. Les mécanismes classiques du rêve s’appliquent pour en étudier le sens : déplacement, condensation, symbolisation.
Selon René Kaës et al. (1989), c’est par son contenu, ses mécanismes et la subjectivité avec laquelle nous y réagissons que le conte de fées se rapproche le plus du rêve. Comme dans le rêve, les actions des personnages dans le conte, aux prises avec leurs conflits, cherchent une issue à leur désir ou à leur besoin. “Chaque personnage constitue un pôle identificatoire possible ou impossible” (p.13). Pour ces auteurs, le personnage a trois fonctions : celles de lien, de transformation et d’intermédiaire. Plus précisément, il relie des processus primaires et secondaires, il transforme des fantasmes inconscients en récits structurés, et agit comme un intermédiaire entre le corps et le milieu social.
(Processus primaire, image, absence de chronologie, rêve ; processus secondaire, récit chronologique)
Pour René Diatkine (1998), l’analyse d’un conte ne doit pas être orientée par la recherche d’une signification unique. Dans l’analyse d’un rêve, la polysémie des personnages, des objets, des lieux et des actions permet d’aborder les formes les plus cachées de chacun de nous.
Roman familial
Marthe Robert nous rappelle que Freud avait montré que les rêveries éveillées de ses patients, qu’elle nomme le « folklore » de ses patients, étaient une forme de fiction élémentaire. Alors qu’elle était consciente chez l’enfant elle devenait, la plupart du temps, inconsciente chez les adultes.
Freud avait trouvé un terme très évocateur pour cette activité psychique le « roman familial des névrosés. »
Il s’agit la plupart du temps d’une situation dans laquelle un enfant s’interroge sur ses origines et s’imagine avoir des parents illustres, avec une conviction enfantine proportionnelle à la détresse dans laquelle il se trouve lorsqu’il prend conscience que ses parents ne sont pas aussi forts, puissants, justes, gentils et aimants qu’il l’imaginait dans sa prime enfance.
Les contes, les mythes et les romans en seraient la forme « adulte » selon Marthe Robert.
Mères et filles
C’est surtout la fonction maternelle, ou maternante qui a été étudiée dans les contes populaires. Elle peut être représentée par la mère ou un substitut maternel bon (lavandière, fée ou sage-femme, marraine, auxiliaire animal porteur de nourriture) mais aussi mauvais (marâtre, sorcière, ogresse).
Le personnage de la mère dans de nombreux contes reflète un trait particulier d’angoisse qui est l’inquiétante étrangeté de la situation dans les contes.
Un conte Coréen très répandu condense les contes classiques du Petit chaperon rouge et des 7 chevreaux. « Trois enfants sont restés à la maison tandis que leur mère est sortie. Un tigre la dévore et revêt son apparence. Ainsi, la mère se fait ouvrir la porte par les enfants. Elle emmène le plus jeune dans la cuisine et s’enferme avec lui. Les deux aînés entendent un craquement d’os. Intrigués, ils regardent par la fente de la porte : leur mère est assise et mange. Mais la vision se transforme : c’est un tigre avec la main de leur petit frère dans la gueule. Les enfants s’enfuient à toutes jambes et se réfugient sur un arbre. »
Ainsi la mère peut se changer en tigre et dévorer ses enfants !
Ce conte illustre également une autre facette classique de l’enseignement des contes : l’intérieur de la maison n’est pas toujours un gage de sécurité !
Les attentions maternelles sont heimlich (bonnes, familières) tant qu’elles garantissent la constance, le retour du même, les allers-retours de bons procédés, la répétition quotidienne des repas et des soins dis maternels. Les contes dramatisent et scénarisent les bienfaits du don premier de la mère à son enfant, à sa fille, (le non-retour de la personne rassurante, sa mort, sa transformation en méchant…).
Le familier (heimlich en allemand) est du côté de la douceur, des échanges de bons procédés, du respect de l’identité de l’autre, de sa différence ; il peut en, un instant, basculer vers l’inquiétante étrangeté (unheimlich en allemand) de la sauvagerie, du cannibalisme et de la sexualité. Le procédé en est connu, c’est le secret de l’intimité qui ouvre la porte des fantasmes et des cauchemars.
Dedans et dehors s’opposent classiquement mais l’intérieur dans les contes est aussi la gueule et l’estomac du loup qui figure une force d’effraction. Le loup est dans les contes le personnage qui favorise la transgression et accompagne la quête d’identité (le loup est aussi un masque).
Pierre Lafforgue faisait remarquer que, dans les contes, la mère bonne était la mère morte !
Dans un conte populaire en Afrique du Nord, (Contes berbères du Maroc ; E. Laoust, Paris, Larose, 1949), deux enfants sont maltraités ou abandonnés, une vache les nourrit, le conte révèle que c’est leur mère morte qui s’est réincarnée en vache nourricière.
La bienfaisance maternelle prend une dimension sacrée, c’est Mère Nature qui dans sa capacité créative, sa prodigalité infinie, procure sécurité, chaleur, nourriture à l’être humain qui en est privé.
Ainsi le plus souvent dans les contes, on s’aperçoit que c’est de la mère morte et non de celle qui est vivante que provient tout ce qui est bienfaisant.
Dans le conte de Peau d’âne, c’est le noisetier planté par l’enfant sur la tombe de sa mère morte qui lui procurera les trois robes merveilleuses dont elle se servira pour séduire le Prince.
La fille dans les contes est étudiée sous l’angle de la fratrie, et plus rarement, comme le souligne Caroline Eliacheff, sous l’angle des relations mère-fille. Dans une version de Cendrillon, les sœurs dévorent leur mère, Cendrillon conserve les os qui lui confèrent la protection magique de sa mère. Dans les contes de Grimm, les filles sont présentées comme des figures doubles : belle/laide, bonne/méchante, vaillante/paresseuse, intelligente /sotte, aimée/persécutée. (P. Laforgue)
Les relations entre la fille et la mère ou ses substituts se centre la plupart du temps, dans les contes, sur l’aspect œdipien de leur relation. Cela nécessite autant pour la mère que pour la fille une remise en question très forte de l’ambivalence naturelle de leurs sentiments vis-à-vis l’une de l’autre.
Il s’agit pour l’une d’entrer, d’un point de vue anthropologique et physiologique dans une période d’activité sexuelle et de reproduction possible, avec toute la gamme des possibles à notre époque. Pour l’autre, la mère, de laisser à sa fille la possibilité d’occuper cette place tout en acceptant de se diriger vers une modification de sa sexualité et la perte de la possibilité d’enfanter.
Le don et le contre don
L’éditeur des Contes de Perrault, raconte qu’il a lu l’histoire de petit chaperon rouge à sa fille, il fut très étonné de l’entendre qualifier le loup de gentil. Lorsqu’il lui demanda pourquoi, elle dit tout simplement : « car il n’a pas mangé la galette ! »
Ainsi chaque enfant suit l’histoire selon un fil qui lui est propre.
Identitaire, narcissique, oral ou œdipien ; en lien avec quelques fantasmes ou angoisses de séparation qui l’occupent. Mais l’objet du don reste précieux et sa transmission déterminant pour la pérennité du processus.
Les histoires de dévoration posent clairement la question : comment peut-il y avoir une place pour deux ? Ce qui est mis en péril c’est l’intégrité su soi corporel, le risque c’est d’être détruit.
Les histoires de rivalité posent une autre question : comment peut-il y avoir une place pour une tierce personne ?
Dans ce cas ce qui est menacé c’est la valeur que l’on a aux yeux d’un autre. Le don à l’autre, sans retour peut représenter le lien qui prend valeur pour un tiers.
La petite fille qui était soulagée que le loup n’ait pas dévoré la galette en avait une conscience intuitive aigue.
D’autres contes donnent une intensité très particulière à ce que l’on nommera le duel mère-fille dont l’enjeu est toujours le regard d’un tiers. Blanche neige en est l’illustration.
Deux ou trois contes très connus sont souvent cités comme outil de recherche anthropologique (Yvonne Verdier), sociologique ou psychanalytique (B. Bettelheim, C. Eliacheff, …), en ce qui concerne l’étude des relations mères-filles, Le petit chaperon rouge, Blanche neige et enfin Cendrillon. Ils ont tous trois la particularité de parler d’une période particulière du développement de l’enfant : la fin de ce que l’on nommait la période de latence et l’entrée dans la puberté et l’adolescence. Il s’agit ainsi de contes qui mettent au travail la question de la transmission des savoirs féminins en particulier au sujet de l’entrée dans la sexualité génitale. (Y. Verdier, C. Eliacheff, Bettelheim, P. Laforgue…)
Dans cet exposé, je resterai au niveau d’une étude très large des relations mères-filles dans leurs aspects psychologiques et anthropologiques, laissant de côté les aspects sociologiques et culturels qui ont bien sûr un rôle important dans l’évolution de ces relations.
On sait par exemple que les sociétés traditionnelles mettent en tension l’aspiration individuelle à se libérer de la contrainte groupale et de la rigidité des normes sociales qui assignent l’individu à une place prédéterminée.
Enfin, pour clore cette longue introduction, je soulignerais, avec d’autres auteurs bien sûr, le fait apparemment simple, qu’un conte se dit. Une mère lit ou raconte une histoire à sa fille avant de dormir. Une intimité se crée, à cet instant elles entrent toutes deux dans l’espace-temps d’un être ensemble. La voix maternelle institue un espace de sécurité qui permet aux péripéties dramatiques du conte de se dérouler dans un entre-d ’eux. La voix rend présent le corps de l’adulte tout en préservant l’enfant de sa dimension excitante, pressante.
Nous entrons dans le temps et l’espace d’une interprétation. La parole, tissée avec la sensorialité de la voix, sert au déroulé, à l’enchainement de motifs préexistants. La tension d’une intensité secrète y trouve un apaisement : « celui de se retrouver en des formes qui appartiennent à tous et à personne ». (F. Flahault)
Et si nous passions un peu de temps avec le Petit Chaperon Rouge et avec Blanche Neige pour n’évoquer que les contes les plus populaires nous pourrons en extraire des enseignements étonnants quant aux relations mères filles qui est notre fil d’Ariane aujourd’hui.
Le Petit Chaperon Rouge
« Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu’on eût su voir ; sa mère en était folle, et sa grand-mère plus folle encore ». (Perrault)
Le thème central de ce conte, outre la peur de la petite fille d’être dévorée est l’histoire du trajet à accomplir, à l’entrée de la puberté, vers les différents états de femme, de mère et de grand-mère.
La mère a une dette vis-à-vis de sa propre mère, en confiant la mission à sa fille, vêtue du petit chaperon rouge offert par la grand-mère, elle va chercher à s’en acquitter.
Dans cet « entre-deux-meres » (Claude de la Genardière) le PChR rencontrera le loup séducteur qui n’aura de cesse de vouloir la manger.
La version de frères Grimm se termine moins radicalement que celle de Perrault (1628-1703) qui laisse le loup avoir le dernier coup de dents.
Chez les frères Grimm (Jacob, 1785-1863 ; Wilhem, 1786-1859), le PChR et la Mère-Grand seront sauvés par une figure paternelle, un chasseur qui poursuivait le loup et le tuera après avoir délicatement libéré l’enfant et la grand-mère.
Delarue, mais aussi Yvonne Verdier, démontreront l’aspect bourgeois et réducteur du conte de Perrault qui transforme la petite paysanne en un « modèle de petite bourgeoise, impuissante, naïve et coupable ». Au contraire d’une paysanne de l’époque qui considère tout ce qui touche au corps et à la sexualité comme naturel et sait très bien faire face aux séducteurs éventuels.
Un autre aspect est développé par certains auteurs dont Claude de la Genardière, (Encore un conte ? Le petit chaperon rouge à l’usage des adultes, PU de Nancy, 1993.) qui met l’accent sur la « folie des mères » qui aiment trop leur enfant au risque de le perdre.
L’analyse très classique de Bruno Bettheleim (1976) des contes de fée laisse de côté les aspects narcissiques primaires, identitaires pour se concentrer sur l’aspect narcissiques secondaires et œdipien du conte.
L’accent est mis sur la question des désirs œdipiens, et du danger de la séduction.
Sa sexualité naissante la pousse à s’écarter du chemin et à s’opposer à sa mère.
Elle est ambivalente et confrontée à des désirs contradictoires, obéir à sa mère ou laisser libre cours à son désir d’émancipation. Le chemin des aiguilles et le chemin des épingles.
Dans la maison des parents, la petite fille est protégée de ses désirs, alors que dans la maison de sa grand-mère, elle se trouve angoissée des conséquences de sa rencontre avec le loup.
Son ambivalence entre le principe de réalité (imposé par sa mère) et le principe de plaisir (son propre désir) évoque son conflit intérieur.
Il s’agirait d’un conflit entre le ça et le moi surmoi ; tous les enfants qui éprouvent des difficultés à obéir au principe de réalité, s’identifient très vite avec l’image du Petit Chaperon rouge.
« Le problème qu’elle doit résoudre, ce sont les liens œdipiens qui peuvent l’amener à s’exposer aux tentatives d’un dangereux séducteur (le loup). »
Dans la version des frères Grimm, le Petit Chaperon rouge revient en vie aussi bien que sa grand-mère avec l’intervention du chasseur.
Cela permet aux enfants d’accéder à un stade supérieur d’existence et de pouvoir dépasser leurs peurs par rapport à ce temps transitoire de la période de latence à la puberté.
La plupart des interprétations psychanalytiques de l’histoire du Petit Chaperon rouge mettent l’accent sur la sexualité pubertaire, comme nous l’avons déjà mentionné. Cette sexualité reflète des issues spécifiques comme les sentiments œdipiens du Petit Chaperon rouge envers son père qui est représenté par le loup ou le chasseur.
Il existe un test psychologique, le Fairy Tale Test. (FTT)
Lorsqu’il est présenté la planche du Petit Chaperon rouge, les filles évoquent en général une angoisse de séparation et de mort pour leurs proches. Il s’agit d’une préoccupation ambivalente qui permet à l’enfant d’explorer des solutions agressives à un conflit œdipien inconscient.
Les pensées sont souvent monopolisées par des peurs irrationnelles et de l’angoisse.
Pendant que la jeune fille se promène dans la forêt, elle devient angoissée par la tombée de la nuit, les animaux sauvages, le fait que quelqu’un la regarde, qu’elle peut tomber dans un piège, qu’elle peut se perdre, que sa grand-mère peut mourir, sa mère tombe malade, etc.
Une fille de 9 ans répond à la planche III : “Elle pense que sa grand-mère peut mourir et que cela ne vaut plus la peine de lui amener de la nourriture, elle a peur, sa grand-mère peut être morte et si elle va chez elle, elle peut rencontrer un fantôme qui la mangerait.”
Un autre exemple est la réponse donnée par une fille de 8 ans à la deuxième planche représentant le Petit Chaperon rouge : “Sa mère est morte à cause des problèmes cardiaques et elle est seule dans la rue. Elle ne sait pas quoi faire. Elle est très triste que sa mère soit morte”.
L’histoire du Petit Chaperon rouge tout en reflétant les conflits œdipiens et la sexualité “naissante” de l’héroïne, montre également l’apparition d’un surmoi post œdipien structurant mais également contraignant.
A la question : “Si tu étais le loup, laquelle des trois tu mangerais ? Pourquoi ?”
Les enfants répondent souvent que le loup “mange” l’héroïne qu’il ou elle a perçu comme désobéissante, provocatrice ou maline.
Nous avons vu que le prédateur pouvait aussi être la mère dans le conte du Tigre, c’est en effet une autre interprétation, désormais courante, du personnage du loup qui convoque dans le contage les angoisses et fantasmes identitaires et de dévoration.
C’est dans les liens très précoces des interrelations entre la mère et son enfant que la loi du partage est éprouvante. Les histoires de dévoration « toute crue », outre la distinction cru et cuit développée par Lévi-Strauss entre le sauvage et le civilisé, met en tension la confusion entre dedans/dehors, sauvagerie et civilisation (utilisation d’outils, ciseaux, couteaux pour libérer les enfants engloutis par le loup).
La limite entre les corps, entre dedans/dehors, entre la vie et la mort est abolie, le conte réalise les fantasmes de fusion sans dommage. Ce sont aussi des histoires qui explorent la dialectique entre privation et profusion.
Blanche Neige
« A l’origine, il n’y a pas de place pour deux. »
François Flahault ; Les liens maternels dans les contes de tradition orale. Nouvelle Revue de Psychanalyse, N°45, Printemps 1992, Gallimard.
Le conte de Blanche Neige quant à lui traite à la fois des conflits œdipiens entre la mère et la fille, pendant l’enfance et l’adolescence et aussi des effets désastreux des défauts du narcissisme.
La mère est morte une belle-mère ne tarde pas à la remplacer.
L’attitude de la belle-mère devant son miroir rappelle le thème de Narcisse. Elle est jalouse de la beauté de Blanche Neige aussi bien que de sa jeunesse et de manière symbolique, elle tente de l’incorporer en ayant l’intention de manger ses organes.
Intuitivement chacun d’entre nous qui écoutons ce conte sent la rivalité et la jalousie de la mère vieillissante qui n’accepte pas la dégradation de son corps et de son image et perçoit l’existence d’une fille plus jeune comme une menace pour cette image surinvestie narcissiquement.
La mère et la marâtre sont le produit de la condensation des deux images de mère, la mère du plus jeune âge qui comble les désirs de sa fille et la mère qui frustre et devient une menace pour le rêve œdipien de sa fille lorsqu’elle devient l’amante du père et brise le rêve de remplacement de la mère auprès du père.
La distinction, dans les contes des deux couples de figures maternelles que sont : la mère/la marâtre, ou la mère/la mère-grand, laissent la possibilité d’une identification différenciée à l’un ou l’autre des personnages du conte.
Pour le jeune enfant, cette division est importante, il doit préserver en lui-même l’image d’une mère bonne mais aussi cela lui donne la possibilité de se mettre en colère contre la méchante mère.
Cette division peut avoir lieu aussi pour le moi propre de l’enfant : il peut se diviser en deux êtres, tout bon et tout méchant sans pouvoir intégrer ces deux aspects en une intégrité. Ainsi, “l’enfant extériorise et projette sur quelqu’un d’autre toutes les mauvaises choses qui lui sont effrayantes pour qu’il puisse voir en elles une partie de lui-même”.
Dans ce conte Blanche Neige trouve refuge dans une maison, Walt Disney en a fixé les occupants sous la forme des sept nains mais dans les contes populaires il peut d’agir de frères ou de voleurs.
Dans tous les contes la méchante femme prend une apparence rassurante et se fait ouvrir la porte par l’héroïne. Le don dans ce cas est une pomme ou un autre objet empoisonné. Le don se transforme, il devient mortel et précipite l’héroïne dans un cercueil de verre. L’intrigue de Blanche-neige situe le conte à mi-chemin entre les deux problématiques, celle du lieu d’être (exister) et celle de la valeur (être désirable). La rivalité porte, dans Blanche-neige sur la beauté : le motif du miroir magique condense le duel, l’image du corps, les effets du temps et la voix des autres. (Représentée par les propos du miroir : « vous êtes la plus belle du pays Madame ! »)
L’endormie (la Belle au bois dormant, Blanche neige léthargique) représente pour certains la figure du rêveur et situe les contes dans le registre du rêve plutôt que dans celui des mythes qui en sont souvent la matrice.
L’enjeu de Blanche neige est la constitution de son identité propre et le passage dans une autre catégorie générationnelle.
Tout être doit accepter la succession des générations, l’enfant ne revient pas à ses parents, il s’en éloigne en se transformant après avoir traversé les épreuves de la séparation et des transformations corporelles, psychiques et socio-culturelles de la puberté et de la possibilité que cela procure de devenir mère et plus tard grand-mère.
Bibliographie :
Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fée (1976) Paris, Pluriel ;
Carina Coulacoglou, Auteur du FTT, psychologue d’enfants, Université Pantion d’Athènes, 40E Esperou Str., Kifissia, Athènes 14561, Grèce, e-mail : carina@hol.gr, Cairn ;
Caroline Eliacheff et Nathalie Heinich, Mères-Filles, Une relation à trois, Le livre de poche 2019, Albin Michel 2002 ;
S. Freud, Le roman familial des névrosés (1909), dans, Névrose, psychose et perversion, PUF, 1981 ;
A. Green, Le genre neutre, dans Narcissisme de vie narcissisme de mort,
Ed de Minuit, 1983 ;
Claude de la Genardière, Encore un conte ? Le petit chaperon rouge à l’usage des adultes, PU de Nancy, 1993 ;
F. Héritier, Les deux sœurs et leur mère. Anthropologie de l’inceste, Odile Jacob, 1994 ;
R. Kaës et coll., Contes et Divans, Dunod, 1989 ;
P. Lafforgue, Petit poucet deviendra grand. Le travail du conte, Mollat ed., 1995 ;
Nouvelle Revue de Psychanalyse, Les mères, N° 45, Printemps 1992, Gallimard ;
Marthe Robert, Roman des origines et origine du roman, Tel Gallimard, 2013 ;
Y. Verdier, Le petit chaperon rouge dans la tradition orale.
Annabel
Naissance d’une identité féminine soutenue par une rêverie maternelle secrète.
Annabel est le titre d’un livre de Kathleen Winter. (Kathleen Winter, Annabel, 10/18, 2014.)
L’histoire d’Annabel est celle d’un enfant né en 1968, avec un sexe de fille et un sexe de garçon. Le secret de sa différence ne tient pas longtemps et le père l’assigne dans le sexe masculin et le nomme Wayne.
Mais, tandis que, de son côté, le père cherche à gommer la troublante ambiguïté de leur enfant, la mère elle, imagine avec précision ce que serait le fait de vivre avec cette ambiguïté.
Ainsi l’assignation de genre est troublée par les rêveries maternelles infiltrées de sa propre sexualité infantile. (L’assignation de genre consiste à déterminer socialement un caractère lié à une identité sexuelle, masculin, féminin ou neutre, indépendamment du sexe biologique.)
Un bain de secrets, de messages énigmatiques, de désirs et de mots masqués ou exprimés, de consultations médicales discrètes et mensongères, d’opérations diverses pour soutenir le caractère masculin dans lequel il est assigné, accompagnent la petite enfance de Wayne.
On apprendra qu’il « rêve qu’il est une fille » jusqu’à ce qu’il soit opéré en urgence d’une hémorragie interne qui s’avère être une fausse couche spontanée.
Le secret levé, la mère retrouve des couleurs (sic) et le père absent, décide de lire Voltaire dans le Grand Nord où il part, comme chaque année, pour la saison de chasse dans le Grand Nord canadien.
Le livre nous montre que l’assignation au genre masculin est passé par le meurtre du genre féminin.
« J’ai l’impression de ne pas être la seule à avoir perdu sa fille. » dit l’amie de la mère de Wayne qui vient de perdre son mari et sa fille Annabel dans un accident de chasse.
L’assignation au genre masculin est confirmée par le monde médical qui intervient pour « corriger » l’anatomie de l’enfant. L’enfant « peut être élevé comme un garçon » décide le médecin consulté au grand soulagement du père qui appréhende les conséquences sociales de l’ambiguïté sexuelle de son fils.
L’auteur infiltre son récit de confusion quant au genre, ainsi lorsque le personnel féminin de l’hôpital ou la mère parlent du bébé elles disent « elle ».
Nous apprendrons plus tard que les caractères féminins sont omniprésents dans le discours des adultes, parents, enseignants qui vantent la méticulosité de l’enfant qui fait des choses qu’aucun garçon ne ferait, qui a des bras frêles et en souffre car il veut être un garçon fort et aimé par ce père chasseur. Même le père finit par imaginer son enfant habillé en fille.
Au départ les femmes semblent avoir identifié le féminin et les hommes le masculin.
Le clivage est complet et peu réductible dans un premier temps, ce ne sera que la persévérance attentive d’une amie de la mère et le drame de l’arrivée des règles et de la fausse couche qui va changer la donne et précipiter l’adolescent dans une errance à la quête d’une identité mise à mal par son enfance.
La quête qui lui fait tout d’abord interrompre son traitement hormonal, le plonge dans des angoisses et des fantasmes de grossesse et, de retour sur la scène médicale, le livre au regard et à la curiosité estudiantine, lui donnant l’impression d’être un cobaye : « un spécimen destiné à parfaire la formation des étudiants en médecine. »
Son père lui tient un discours empreint de conseils de conformisme et de tendresse qui n’ont pour conséquence que de renforcer et sa détermination et ses angoisses.
Les médecins consultés sont longs à le recevoir et à reconnaitre sa souffrance – ayant arrêté les hormones il recommence à avoir mal au ventre et craint une nouvelle métrorragie – ils sont décrits par l’auteur comme drapés d’un savoir scientifique, érigé en morale normative, ils lui conseillent de nouveau la nécessité de rester dans son genre et de reprendre son traitement.
La rencontre avec une femme, une jeune interne qui lui signifie qu’il a un appareil génital féminin complet et en bon état est une révélation.
L’assignation au genre masculin vacille avec la découverte d’un sexe féminin et d’une identité : Annabel.
Annabel est le prénom de la fille décédée de l’amie de sa mère, dont il qualifie secrètement depuis longtemps, sans l’avoir jamais entendu prononcé par un autre, cette part féminine qui l’habite depuis sa naissance.
Suivent la lente, patiente, exigeante et dangereuse appropriation de l’identité féminine.
Wayne quitte le corps de son hôte pour laisser la place à Annabel au cours d’une séance de shopping et de maquillage d’anthologie.
Une fois encore c’est le regard d’une femme, ancienne institutrice qui vient adouber l’identité de Wayne/Annabel.
Les femmes apparaissent en général comme des fées attentives, bienveillantes et compréhensives.
Les figures masculines sont au fond plus complexes, hantés par la culpabilité, soumis à des impératifs surmoïques intransigeants ou à des pulsions agressives, violentes et destructrices.
La figure paternelle, passé les interrogations et la perplexité, est présentée sous une forme post œdipienne protectrice.
La fin du récit nous fait changer d’univers, l’accès à l’université dédramatise le côté androgyne, étrange du garçon qui rencontre des étudiants qui « ont l’air, comme lui, à la fois masculin et féminin ».
Annabel disparait du récit, comme si le passage par l’expérience paradoxalement tendre et traumatique de la rencontre du féminin de Wayne, le fait de nommer cette partie intime avait pu lui permettre de rentrer dans un travail de deuil.
Le féminin longtemps encrypté, noyau mélancolique dont la forme corporelle était le vagin obturé, suturé avec sa libération du corps, lui permettait d’entrer dans un travail de deuil et libère la pensée.
Le long hiver dépressif, l’errance, la quête identitaire trouve une issue dans la rencontre avec la directrice d’école, personnage dont la bienveillante marquait la fin du calvaire et une possible rédemption par la reprise des études.
Les retrouvailles avec une amie chanteuse qui avait retrouvé sa voix, littéralement perdue, enchantait la fin du récit accompagnée par le Cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré.
MUSIQUE
Répands sur nous le feu de ta grâce… Cantique de Jean Racine ;
Annabel, Tales of us par Goldfrapp ( 2014) (nos histoires)
Les problématiques transgenres, intersexuées, d’ambiguïté sexuelle bien que d’origine, d’étiologie différentes posent toujours la question de l’identité psychosexuelle et des origines de cette identité.
Ils vont, pour nous, porter l’éclairage sur la question d’un lien précoce, singulier qui unit la mère à sa fille pour toujours.
Paul Denis, un psychanalyste contemporain, évoque, dans un article : Narcisse indifférent, la différence entre narcissisme primaire et relation d’objet primaire.
Il nous dit que la première relation d’objet serait d’ordre narcissique, les deux protagonistes seraient vécus comme semblables de même sexe. La sortie du narcissisme primaire se ferait par dédoublement : « l’autre apparait dans une relation tout à la fois homosexuelle, indifférenciée quant au sexe, et narcissique. » (p122)
C’est de la reconnaissance de la différence des sexes et son avènement au centre de la vie psychique qui devraient mettre un terme à l’homosexualité primaire.
Pour résumer : « Une forme d’« indifférence des sexes » présiderait donc au débuts de l’organisation libidinale et précèderait l’installation du complexe d’œdipe, lequel se constitue sur un investissement exacerbé de la différence anatomique entre les sexes. » (p.126, Paul Denis)
A la période de latence la différence des sexes s’estomperait devant la différence des générations. Le travail psychique tend à l’indifférence face au sexe anatomique, sa reconnaissance, la perception de l’infériorité face aux adultes ayant une valence castratrice intolérable.
A l’adolescence l’indifférence des sexes est voulue, organisée dans tout un ensemble de conduites collectives. Les bandes d’adolescents évoluent « sous le signe d’Antéros » qui « constitue cette part de la sexualité consacrée au groupe… Homogénérationnelle, vécue entre semblables, elle est narcissique, homosexuelle par nature. » (p128)
Notre cas, Wayne/Annabel a traversé ces vicissitudes sans gloire, dans une souffrance indicible proche de l’agonie psychique.
Christophe Dejours, dans un questionnement fort de l’identité et des pratiques Queer reprend la notion d’introjection dans L’indifférence des sexes : fiction ou défi ? En suivant les développements d’Abraham et Torok il insiste sur la notion de processus « l’introjection est un travail de deuil, Trauerarbeit, qui implique un travail de pensée et de transformation de soi, de réaménagement psychique. »
Dans la mélancolie il n’y a pas de processus, il y a une « opération magique qui passe par le phantasme d’une incorporation orale de l’objet perdu, l’incorporation impliquant une « disparition de la conscience du sujet et un logement de l’objet dans le corps même. » (p.53)
C’est tout ce travail de subjectivation qui est parcouru d’une tension extrême entre le narcissique et l’objectal que l’auteur de Annabel nous permet de suivre pas à pas.
Ainsi, pour conclure ce chapitre, je reprendrais une phrase de Christophe Dejours : « l’identité sexuelle ne doit rien à l’anatomie, ni à la physiologie. Elle résulte fondamentalement du travail psychique de l’enfant sur les messages adressés par l’adulte… il n’y a aucune naturalité dans l’identité sexuelle…elle est rigoureusement fantasmatique comme l’est toute la sexualité infantile. Et si l’identité sexuelle est stable tout au long de la vie et, même si elle se constitue précocement, elle est tributaire du genre. »
Bibliographie
Bernard Andrieu et Gilles Boëtsch, Dictionnaire du corps, Biblis ;
Caroline Eliacheff et Nathalie Heinich, Mères-Filles, Une relation à trois, Le livre de poche 2019, Albin Michel 2002 ;
S. Freud, Le roman familial des névrosés (1909), dans, Névrose, psychose et perversion, PUF, 1981 ;
A. Green, Le genre neutre, dans Narcissisme de vie narcissisme de mort,
Ed de Minuit, 1983 ;
Le présent de la psychanalyse, Les folies de la norme, Revue de l’APF, n°2, septembre 2019, Puf
Nouvelle Revue de Psychanalyse, Bisexualité et différence des sexes, N° 7, Printemps, 1973, Gallimard ;
JY Tamet, H. Normand, Le genre inquiet, Le présent dans la psychanalyse APF n°2 septembre 2019 ;
Kathleen Winter, Annabel, 10/18 ;
Madame de Sévigné et sa fille Mme de Grignan.
« Le théâtre athénien était plein de la douleur des mères grecques, de la souffrance de la séparation entre la mère et sa fille, par le mariage ou par la mort. » Louise Bruit Zaidman.
Marie-Magdeleine Lessana fait du cas de Madame de Sévigné le paradigme du ravage dans les relations mères filles. (Entre mère et fille : un ravage.)
Pour cette auteure, la fille de Mme de Sévigné « lui sert de peau qui la pare, dans le sens de parure et de protection. Parure pour plaire ; protection, contre la sexualité avec son mari » et ensuite, après le décès de celui-ci avec tous ses prétendants.
IL est dit de sa fille qu’elle est :
– « La plus jolie fille de France ». Elle est admise à la cour grâce aux efforts de sa mère et danse avec le roi soleil.
– « Un soleil qui ne fait que naitre / Dans le sein d’un autre soleil ».
Le poète Ménage, écrit en 1663 :
– « Vous n’aimez point votre fille / Ce miracle de nos jours. / Par l’éclat incomparable / De votre teint, de vos yeux, / Par votre esprit adorable, / Vous l’effacez en tous lieux. »
En 1669, Françoise Marguerite épouse le Comte de Grignan, il s’agit d’un mariage de convention que Madame de Sévigné aurait négocié à prix fort. Le comte est doublement veuf, âgé de 37 ans il est père de deux enfants. Il semblerait cependant qu’il soit amoureux de Françoise Marguerite qui a 23 ans. Il sera nommé par Louis XIV Lieutenant général de la Provence et le couple devra quitter Paris.
L’enjeu du changement de statut est payé au prix fort de l’éloignement de la cour.
Mariage arrangé, mort du premier né.
Renversement de l’amour en haine.
Le deuxième enfant est confié à sa grand-mère qui donne un diamant à Mme de Grignan.
Il s’agit d’un échange de don qui a, pour Madame de Sévigné une fonction : que sa fille se souvienne d’elle et de l’excessive tendresse qu’elle a à son égard. (Pas que sa fille se souvienne du diamant qu’elle vient de lui confier : sa fille !)
Du côté de Mme de Sévigné, la séparation est un « arrachement », elle ressent pendant des mois une douleur aigue et ne peut pas imaginer que sa fille ne soit pas en danger de mort loin d’elle.
Une déclaration d’amour folle pour sa fille qu’elle « idolâtre ». « Je suis absolument et si entièrement à vous qu’il n’est pas possible d’y ajouter la moindre chose… Je vous aime au-delà de ce qu’on peut imaginer… Je suis à vous sans aucune exagération ni fin de lettre hasta la muerte inclusivement. »
Des vœux de mort des deux côtés. L’absence de pudeur dans les confidences sexuelles des enfants à leur mère qui entend gérer leur sexualité. Le fils de Mme de Sévigné partage les mêmes maitresses que le père défunt.
Une fois le mari disparu, il semble qu’une haine sourde se soit progressivement infiltrée dans l’amour exclusif que Mme de Sévigné va vouer à sa fille qui se réfugie dans le silence jusqu’à l’accouchement de son deuxième enfant.
Comme si la passion dévorante pour le défunt mari, pourtant absent et libertin, c’était massivement déplacée sur sa fille qui devient son principal sujet d’attention et de préoccupation.
Cet attachement particulièrement envahissant et exigeant de la mère à sa fille se nourrit certainement d’une carence identitaire et narcissique.
Marie, la future Madame de Sévigné, est l’enfant unique du couple parental. Il s’agit d’une mésalliance du côté paternel qui est d’ancienne noblesse alors que la mère de Marie est issue de la bourgeoisie « élevée par la finance » ; (La famille maternelle les de Coulange sont de récente noblesse, originaire des architectes qui ont construit la place des Vosges à Paris). Madame de Sévigné a perdu son père quand elle avait un an et sa mère à 7 ans. Les deux familles se disputèrent en justice la charge d’élever leur petite fille.
Là encore la disparition d’un tiers vient obturer les possibilités de séparation dans le respect des cheminements individuels et du respect de la pluralité des relations possibles.
La correspondance entre Mme de Sévigné et sa fille commencera après le départ de celle-ci : « un arrachement inouï dont la mère ne se remettra jamais » écrit l’auteur de l’ouvrage. La pratique même des lettres devient pour la mère l’expression de son extrême et excessive tendresse. L’élan amoureux ne se révèlera qu’en l’absence de l’être aimé. La correspondance est remarquable car elle durera un quart de siècle à raison d’environ deux lettres par semaine écrites toujours les mêmes jours. Les lettres, plus de mille adressées à sa fille, seront publiées après la mort de Madame de Sévigné.
Aux yeux de Mme de Sévigné, sa fille parait tout le temps en danger, menacée de mort.
On retrouve là l’ambivalence œdipienne de cette inquiétude qui peut s’entendre comme un vœu de mort retourné en son contraire, la culpabilité en lien avec la jalousie, certainement due aux réussites de sa fille, n’est pas du tout assumée et projetée sur la scène relationnelle et transformée en angoisse excessive de mort pour sa fille.
Mme de Sévigné se sent « persécutée par le manque de sa fille comme on peut l’être par la disparition d’un défunt ». La mort de son mari la laisse seule, (il est dit qu’elle est très affligée et « inconsolable »), sans ressource psychique pour faire face au deuil de la passion qu’elle avait pour lui. Elle transfère massivement cette passion sur sa fille sur le mode d’une relation incestuelle impossible.
Marie Françoise, future Madame de Grignan nait le 10 Octobre 1646, sa mère accouche seule, sans le secours de sa famille qui ne se déplacera pas à son baptême qui se déroule 18 jours après sa naissance
Il existe très peu de témoignage sur les relations qu’elle entretenait avec ses enfants et aucune représentation d’elle-même avec eux. Il semblerait qu’en elle aient cohabités les côtés mondains et maternels avec une nécessité de clivage entre la vie publique et la vie privée qui reste secrète.
Elle apparait cependant comme une star du XVII é siècle, avec la nécessité de tenir compte de l’opinion de son époque, de « gérer son image ».
Elle apparaissait en public avec des enfants faire-valoir de ses qualités maternelles. Ils mettaient également en valeur sa beauté et le peu d’influence du temps sur sa silhouette. « Sa beauté rayonne sur ses enfants » trouve-t-on dans ses biographies, c’est elle qui est admirée et courtisé.
Son attention maternelle est narcissique et en rien objectale, c’est toujours elle qui est mise en avant, elle une de ces « mères étoiles » dont parle Caroline Eliacheff !
Bibliographie :
Marie-Magdeleine Lessana, Entre mère et fille : un ravage, Pluriel, 2020 ;
Caroline Eliacheff et Nathalie Heinich, Mères-Filles, Une relation à trois, Le livre de poche 2019, Albin Michel 2002 ;
Les Déesses-Mères et les Mères-Étoiles.
Déméter et Perséphone.
« Le rêve fait un usage illimité du langage symbolique. Le mythe tout autant. Le rêve se fiche des règles de la pensée logique. Le mythe tout autant. Il y a le contenu apparent du rêve, et les pensées latentes ». Le travail de l’analyse peut les faire apparaitre. Pour le mythe, il en va de même : il y a le texte de l’histoire qui se raconte, et le message qui va émerger lors de l’étude du mythe ou par son interprétation.
Mère des origines, Déméter est un pilier de la mythologie grecque. Plus qu’un nom propre, Déméter semble être un nom générique ; formé de De- renvoyant aux dieux et de -meter signifiant la mère, il peut se traduire par « mère des dieux » selon les analyses de Philippe Borgeaud.
Le mythe de Déméter est relaté par un Hymne homérique (VIIe siècle av. JC) : Perséphone, fille de Déméter, est enlevée par Hadès qui l’enferme en son royaume sous terre appelé les Enfers.
Déméter, accablée de tristesse, cherche sa fille sans trêve. Apprenant qu’elle a été enlevée, elle maudit la terre qui se dessèche alors. Zeus intervient enfin auprès d’Hadès qui relâche Perséphone. Ce n’est qu’au moment où sa fille la rejoint que Déméter lève sa malédiction : alors la terre renaît.
L’iconographie et la statuaire abondent quant à Déméter et Perséphone ; elles témoignent d’une relation faite de douceur et de complicité, empreinte de confiance, d’amour, de tranquillité.
« Dans la famille olympienne, Déméter ne s’impose parmi ses frères et sœurs, qu’à travers sa maternité affirmée, sa revendication de mère dans sa quête de Koré, et son exigence que soit reconnu son rôle dans le choix d’un époux pour sa fille…
L’étroite relation entre la maternité et la fertilité du sol, la nourriture (trophê) d’une descendance et la richesse des productions qui nourrissent les hommes, est illustrée par le mythe de Déméter, à la fois « nourrice » provisoire de Démophon et tutrice de Triptolème dans son rôle de civilisateur par le biais de la culture du blé.
Déméter est une mère pour Koré et pour celles et ceux qui, à travers les cultes qui lui sont rendus ainsi qu’à sa fille, reconnaissent sa puissance sur la génération des humains, la richesse de la terre, la perpétuation des cités. » Ecrit Louise Bruit Zaidman.
Une autre analyse est cependant permise en suivant le chemin ouvert par Caroline Eliacheff lorsqu’elle évoque l’inceste platonique qui prévaut dans certaines relations mère-fille. Dans ces cas c’est le tiers qui est exclu, pas le tiers maternel de l’inceste père-fille, qui est agi, mais le tiers paternel qui ne joue plus aucun rôle séparateur. Nous nous retrouvons dans un registre de fusion narcissique, de même, d’identique impossible à dépasser, la fille occupe, pour la mère la place de son mari.
En clinique nous parlons de relation incestuelle, sans passage à l’acte sexuel mais avec toutes les caractéristiques et les conséquences pathologiques de ce type de lien. Dans le fantasme de « ne faire qu’un », l’exclusion du père annule la différence généalogique et met l’enfant et son parent dans une filiation fantasmatique niant la différence des générations.
Ce type de lien est très fréquent dans nos sociétés modernes, soit parce que le père est inconnu, soit qu’il a abandonné le foyer, soit par simple volonté individuelle, comme revendication toute puissante d’une appropriation du corps et d’un affranchissement des lois naturelles de la procréation. « Faire un bébé toute seule » est devenu assez courant, habituellement cela ne signifie pas du tout que le tiers est exclu, il peut être présent sous différentes formes qui vont permettre un développement satisfaisant de l’enfant.
Mais il existe d’autres cas où le tiers sera exclu pour le plus grand malheur de l’enfant. Caroline Eliacheff dans son analyse du livre La pianiste en montre les aspects dramatiques.
Dans le mythe de Déméter ce n’est que l’intervention d’un tiers, Zeus qui va permettre de sortir du blocage dans lequel la mélancolie furieuse de la mère avait précipité la terre qui se desséchait et dépérissait. En acceptant l’intercession du dieu des dieux, Déméter a accepté que sa fille passe la moitié de l’année aux enfers et l’autre moitié avec elle faisant renaitre la terre et instituant le rythme saisonnier.
Ce récit serait situé à une période de l’histoire durant laquelle le matriarcat perdait de son pouvoir organisateur de la société. La façon la plus fréquente de procréer en dehors du clan était le rapt des jeunes femmes qui étaient ainsi séparées violemment de leur mère et emmenée dans un clan rival. Le récit en proposant une figuration narrative de ces comportements, et une solution alternative, préparait le terrain pour une meilleure civilité des échanges inter clan et précédait l’institution d’une nouvelle alliance dont les formes se déclinent de nos jours par milliers.
L’une devient le miroir de l’autre, l’autre la projection narcissique de l’une, la confusion identitaire domine la réciprocité habituelle du lien.
Le pas est très court de l’abus narcissique à l’inceste platonique. Dans les deux cas l’enfant est considéré comme un objet à disposition de la mère et non comme un sujet ou une personne.
J’ai suivi une patiente qui avaient vécu ce lien quasiment incestueux avec sa mère dans son enfance. Devenue professeur de littérature classique, elle n’a jamais vraiment pu se soustraire à l’emprise maternelle. Elle décrivait avec beaucoup de détails, avec une acuité remplie de colère et de souffrance, les vicissitudes de sa relation avec cette mère qui, en public était la meilleure des mères et la couvrait de baisers et de compliments et, dès la porte de la maison refermée, au mieux l’abandonnait, l’ignorait ou au pire l’insultait et la couvrait de reproches.
Je vous laisse imaginer les dégâts sur la construction de l’estime de soi et sur la sexualité. Le père pourtant présent était relégué à son bureau et sombrait dans une déchéance alcoolique dépressive.
Bibliographie :
Pierre Varrod, Freud chez les Grecs ! La psychanalyse expliquée par la mythologie, Editions de l’opportun ;
Caroline Eliacheff et Nathalie Heinich, Mères-Filles, Une relation à trois, Le livre de poche 2019, Albin Michel 2002 ;
S. Freud, Le roman familial des névrosés (1909), dans, Névrose, psychose et perversion, PUF, 1981 ;
Mères et maternités en Grèce ancienne, Quelques éléments historiographiques et pistes de réflexion, Florence Gherchanoc et Jean-Baptiste Bonnard Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2013 ;
Louise Bruit Zaidman, Déméter-Mère et les figures de la maternité, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2013.
Maud et Nancy Cunard.
Les relations entre Nancy Cunard et sa mère Maud étaient proches de ce modèle qui se complète chez Caroline Eliacheff avec le modèle des Mères-étoiles.
Il est significatif, lorsqu’on lit les biographies de ce couple maudit à quel point il existe une continuité inversée entre les relations de Maud avec sa propre mère et ensuite avec Nancy.
La mère de Maud a été, une Mère aimante, qui n’a pas exclu totalement les tiers dans la vie de Maud qui raconte à quel point elle a aimé son beau- père, refusant l’interprétation de Nancy qui l’accusa d’avoir couché avec lui, ce fut la cause de leur rupture définitive.
Alexandra Lapierre fait raconter à Maud, à la fin de son existence, la singularité fusionnelle de sa relation à sa mère qui partageait toutes ses difficultés et déployait toute sa fortune et son inventivité pour lui trouver un mari après sa déception de la rupture avec le prince Poniatowski. Il semble qu’une fois marié à un bon parti, Maud a pu exister individuellement et de façon somme toute très libre sur le plan sexuel, amical et amoureux, l’aisance financière l’ayant libérée des contraintes laborieuses.
Quant à Nancy, elle n’eut pas vraiment de mère, comme cela était courant dans ce milieu social, elle a été éduquée par des gouvernantes dont on sait peu de choses. A-t-elle été aimée, enfant ? Le fait qu’elle ait survécu parle en cette faveur et elle a dû trouver une « mère qui l’a élevée » en complément de sa « mère qui l’a faite ». Nancy aurait été élevée, dans son plus jeune âge par une gouvernante française, dont elle parle dans un de ses poèmes, originaire de Toulon cette jeune femme lui a laissé l’impression d’une personne « rebelle… au rire bruyant et éclatant… » elle avait une voix « pleine de toutes les aventures de sa vie, Son œil si gai, mais un jour elle disparut. » Ensuite Nancy fut affublée d’une remplaçante toute droit échappée d’un roman de Dickens : froide, implacable et méchante qui élevait l’enfant « à coup de triques », de privations et d’humiliations. Nancy subit sans rien dire, trop timide pour se plaindre ! Elle reconnaitra cependant, en l’admirant, l’intelligence et la culture de Miss Scarth qui sera certainement renvoyée en 1910 lorsque les parents de Nancy décident de l’inscrire dans une école privée.
Elle se réfugie dans un monde imaginaire, s’isole, se replie sur elle-même. Mais, écrit un de ses biographes François Buot, « Elle comprend aussi que si elle veut vivre sa vie, il va lui falloir tricher, mentir, comploter. D’un point de vue psychopathologique on peut sans se tromper supposer qu’elle a fait un repli dépressif à la perte inexpliquée de la gouvernante française. Je n’oserais pas émettre l’hypothèse que Nancy, toute sa vie a recherché ce substitut maternel dans la proximité qu’elle pouvait avoir avec des gens simples, étrangers à son milieu social d’origine et que son goût prononcé pour la lutte contre l’injustice trouve ses racines dans ces premiers traumatismes infantiles et cette séparation brutale et inexplicable.
Il est très peu question du rôle paternel dans l’éducation de l’enfant, ce qui plaide en la faveur de son exclusion comme tiers. En fait il semble que Nancy se soit « inventé d’autres pères beaucoup plus exaltants » que Sir Bache Cunard au tempérament solitaire qui aimait rester dans les « brumes de Nevill Holt » (propriété familiale où est née Nancy en Mars 1896), nous dit François Buot. C’est cependant Nancy qui sera auprès de lui dans ses derniers instants de vie, (le 3 Novembre 1925), elle respectera ses derniers vœux et organisera une cérémonie « des plus sobres » comme il le souhaitait.
Elle a eu une mère brillante, auto centrée et très active tant artistiquement, socialement que dans sa vie amoureuse. François Buot écrit que Nancy était très attachée à sa mère qui était régulièrement absente de la maison et qu’elle attendait son retour en raison de l’animation et des fêtes qui suivaient le sillage de Maud dès qu’elle revenait à Nevill Holt.
Elles ont toutes les deux, précocement, été en rivalité sur le même terrain quand on s’y penche. Ont-elles eu des amants en commun ? C’est une question que je n’ai pas pu trancher, même si les propos de François Buot laissent entendre que Nancy aimait Georges Moore, ont-ils été amants ?
Cela aurait pu les rapprocher mais la mère de Nancy était façonnée d’un autre bois, tout en semblant respecter des conventions aristocratiques de son milieu social, elle a été l’égérie d’une Angleterre tentant de se libérer du carcan puritain de l’époque victorienne. C’est de cela que Nancy, tout au long de sa vie semble avoir voulu se détacher tout en l’utilisant si cela lui était nécessaire. C’était toutes deux de très belles femmes icones de leur milieu socio culturel, et relativement libérées des contraintes bourgeoises. La rivalité vis-à-vis des hommes a été très vive et il semble que Maud n’a pas été dans la possibilité de changer et d’évoluer vers un lien plus tempéré avec les hommes qui au font l’ont souvent abandonnée et ont préféré des unions plus « socialement correctes ».
Nancy n’a pas été soumise à cet impératif, ses amants lui sont restés fidèles en amitié mais sans lui procurer une stabilité et une sécurité dont, sans sembler en avoir besoin, elle se serait peut-être accommodée. Toute sa vie elle a cherché à remplir un vide affectif que ses nombreuses aventures amoureuses n’ont jamais vraiment comblé.
Tous les ingrédients étaient là pour faire de ses personnages des héroïnes romanesques et au font c’est ce qu’elles sont devenues dans le livre d’Alexandra Lapierre.
Nancy a-t-elle occupé la place pour sa mère d’enfant miroir pourvoyeur de gratifications, ayant paradoxalement besoin sans cesse d’être approuvée par elle ?
La rigidité émotionnelle et narcissique, en lien avec le milieu aristocratique, a-t-elle constitué, pour Maud, la défense majeure contre la culpabilité suscitée par ses relations avec sa fille ?
On sait peu de choses sur la petite enfance de Nancy. Mais l’évolution du personnage maternel laisse imaginer qu’il en a été ainsi. Maud n’a eu de cesse d’affirmer agressivement sa féminité ; elle n’a jamais cessé d’intégrer ses émotions douloureuses dans sa passion pour les déconnecter de leur source ; le surinvestissement de la vie sociale, festive et amoureuse lui a-t-elle permis d’éviter l’effondrement narcissique et dépressif ?
Mais ne peut-on pas, avec Caroline Eliacheff effectuer une autre analyse des relations entre mères et filles dans cette histoire dont au fond nous ne connaissons que l’aspect public à travers les biographies qui leur sont consacrées.
Toutes les filles ne se reconnaissent pas, bien sûr, dans les drames et les conflits qui sous-tendent les romans, les contes et les mythes que nous abordons. Il existe, mais le genre littéraire les explores peut-être moins, des relations mères-filles harmonieuses et je vous souhaite, mesdames d’en avoir une !
La complicité affichée de certaines relations mères-filles ne risque-t-elle pas de se substituer aux autres relations nécessaires à l’individu ?
Caroline Eliacheff nous fait remarquer que : « dans le passé, les filles reproduisaient majoritairement le destin de leur mère en l’intériorisant, sans forcément vouloir et pouvoir garder une relation avec elle. De nos jours la complicité mère-fille paraît fréquente alors même qu’elle renvoie à une image régressive d’un destin féminin circonscrit aux liens familiaux. »
Pour Freud, nous rappelle cette auteure, « la dette de gratitude qui unit l’enfant à sa mère doit se situer dans le futur et non dans le passé. »
Faute de quoi, la transmission de la vie peut s’interrompre.
« Je te serai toujours reconnaissant, maman ! » Dit un aiglon à sa mère-aigle, à quoi la mère répond : « Menteur ! » Et le laisse tomber.
« J’espère que je serai aussi bonne pour mes enfants que tu l’as été pour moi ! » Dit à sa mère-aigle un autre des enfants. Elle la laisse vivre.
Ainsi nous pouvons nous accorder sur la pluralité des modes de relation mère-filles car il s’agit d’un axe d’analyse qui tient compte de la subjectivité des points de vue. Les comportements peuvent apparaitre objectifs mais leur souvenir, leur récit ou même leur vécu, comme il existe une température réelle et une température ressentie, s’avère sujet à une grande relativité individuelle.
Maud a-t-elle agi comme l’aigle qui laisse tomber l’aiglon-Nancy qui lui ment et, qui loin de s’acquitter de sa dette, n’aura de cesse d’en différer le règlement ? (Nancy n’eut pas de descendance)
Ce qui est certain dans l’observation de l’histoire de leur vie c’est que leur relation, après avoir été très proche, c’est brisé sur les récifs de l’amour et de la passion. Le manque de mobilité relationnelle a favorisé l’installation d’un lien passionnel et d’un destin tragique du devenir-femme en instituant une rivalité implacable, aliénante et mortifère.
Bien-sûr on peut s’accorder sur la modernité excitante du statut de femme de ces deux personnages. Toutes deux libérées sexuellement, elles ont un parcours brillant, semé de réussites artistiques. Mais, rejeté par leur milieu social d’origine, leur nom restera dans l’histoire associé à celui des hommes qu’elles ont fréquenté, …. Son mari, ses amants, pour Maud ; Aragon, les artistes qu’elle a soutenus et ses engagements politiques révolutionnaires pour Nancy.
Elles ont toute leur vie été en lien de toute les façons possibles pourrait-on dire et, même longtemps après leur mort, les romanciers et les biographes n’ont de cesse de tenter de les réunir dans leurs écrits les érigeant en mythe moderne d’une évolution sociétale imprévisible et intemporelle.
Bibliographie :
François Buot, Nancy Cunard, Pauvert, 2019 ;
Sophie Carquain, Trois filles et leurs mères, ed. Leduc.s, Charleston, 2018
Caroline Eliacheff et Nathalie Heinich, Mères-Filles, Une relation à trois, Le livre de poche 2019, Albin Michel 2002 ;
A.Naouri, Les filles et leur mère, Odile Jacob, 1998 ;
Représentations dans l’art et dans la presse des relations mères filles de l’antiquité à nos jours.
J’ai recherché les représentations de mère avec leur fille dans la peinture de l’antiquité au XVIII é siècle et il s’avère que le sujet est très peu présent, et qu’il semble surtout abordé par des femmes.
Il y a bien sûr le bas-relief Déméter et sa fille Perséphone prisonnière des enfers. Les deux personnages se font face et rien ne les différentie vraiment elles ne se regardent pas vraiment et tiennent chacune une sorte de petit arbre qu’elles érigent plus ou moins vers le ciel, elles ont la même coiffure, les mêmes traits de visage.
IMAGES
Les relations mères/enfants dans l’antiquité peuvent être pensées en termes de don et de transmission et conduisent à étudier un certain nombre de « figures » maternelles emblématiques.
La mère peut donner (ou doit donner ?) à ses enfants une trophê, de la philia et une certaine forme de paideia. Une mère n’est pas seulement celle qui porte et met au monde un enfant, elle est aussi celle qui nourrit et soigne le nouveau-né, puis accompagne l’enfant jusqu’à un âge avancé (peut-être l’hêbê). La nourriture que procure la « mère » au nourrisson est en effet une nourriture naturelle fabriquée par le corps de la femme, donc non cultivée, contrairement à l’orge et au blé que produisent les hommes.
Découle de cette interrogation sur la relation affective mère-enfant et sur son évolution éventuelle toute une série de problématiques sur l’instrumentalisation des relations mère/fille par rapport aux relations mère/fils, sur la manière dont la figure paternelle interagit dans cette relation.
Les mères ont aussi en charge, manifestement, l’éducation des garçons jusqu’à l’âge de sept ans environ et celle des filles jusqu’à leur mariage.
L’ensemble débouche, enfin, sur les aspects politiques et religieux de la maternité, sur l’importance de la mère en termes de légitimation, de filiation, donc d’identité sociale, sur le rôle, la place et l’influence des mères dans les cités grecques, largement sous-évalués par rapport à ceux des pères.
Au XVII é siècle, le mode de représentation reflète la perception de la relation des personnes en fonction du milieu social. L’aristocratie ou la haute bourgeoisie se figure sur le modèle de la valorisation de la mère, l’enfant semble un faire-valoir, un accessoire, il n’y a aucune tendresse représentée et l’enfant est debout aux côtés de sa mère qui, elle est assise comme dans le « Portait d’une dame de qualité et sa fille » de Antoon Van Dyck (1599-1641) Le Louvre
IMAGE
(« Assise de trois quarts, légèrement en biais, dans un fauteuil au dossier rouge, une dame d’un rang de toute apparence élevé, tête nue et vêtue d’une robe en satin noir rebrodé, rehaussée d’un large col et de manchettes en dentelle fine, tourne la tête et un regard pensif vers la droite. Elle porte de nombreux bijoux, dont un discret ornement dans ses cheveux relevés, des pendants d’oreilles et un ras du cou en perles, une croix d’or enrichie de pierreries sur la poitrine, ainsi qu’une chaîne d’or à trois rangs. A droite auprès d’elle, debout, les mains croisées devant elle, se tient sagement une fillette à la robe blanche retroussée sur un jupon bordé de quatre galons d’or, regardant le spectateur d’un air mutin. Elle porte, comme sa mère, un collier de perles au ras du cou. La lumière traverse la scène en diagonale, caressant au passage les reflets lustrés du tissu noir et laissant à dessein la partie gauche du tableau dans la pénombre. Un pan de rideau mordoré sur lequel se détachent avec délicatesse les carnations du visage de la mère, un rectangle de ciel sur la droite, deux colonnes adossées, composent le fond du tableau. Au noir intense et profond de la robe, viennent s’opposer les touches de blanc des nuages, le nacré des perles et du satin de la robe de la fillette, l’élégance arachnéenne de la dentelle, mais aussi la touche rouge du fauteuil et le drapé doré du rideau et de la parure. Les différentes diagonales qui traversent la scène représentée, donnent aux deux modèles un mouvement imperceptible, mais présent, malgré leur apparente immobilité ».)
IL semblerait que c’est la peintre Élisabeth Vigée Le Brun (aussi appelée Élisabeth Vigée, Élisabeth Le Brun ou Élisabeth Lebrun, née Louise-Élisabeth Vigée le 16 avril 1755 à Paris, et morte dans la même ville le 30 mars 1842, est une artiste peintre française, considérée comme une grande portraitiste de son temps.) qui ait ouvert la voie à une représentation plus naturelle de la relation mère-fille dans un autoportrait avec sa fille en 1786, tableau actuellement exposé au Louvre. On y voit une mère heureuse, aimante et fière de poser avec son enfant qui est bien vivante, souriante, il n’y a pas de condescendance de la part de la mère, le port de l’enfant est naturel et enjoué.
Le portrait de Caroline Murat, Reine de Naples et de sa fille Laetitia, par le même peintre est différent dans la posture qui est marquée par la dignité de la fonction maternelle, mais les sourires de l’enfant et de la mère leur confèrent une humanité et une complicité entre les deux personnages qui semble naturelle et adoucit l’austérité du maintien postural.
IMAGE
Une rapide recherche sur le net m’a tout de suite plongé dans le présent d’une certaine mode qui projette sur nos écrans, dans les magazines féminins des thèmes, qui bien que anciens, sont souvent présentés comme actuels, modernes et significatifs d’une évolution voire d’un renouveau des relations mères filles.
Paris Match dans une série : 1949-2019, au sujet de « nos années 1950 » met en scène la maternité princière de Grace Kelly qu’ils se targuent de « faire La Princesse de Monaco ». On y trouve deux photos où l’ancienne actrice fétiche de Hitchcock pose en tant que mère.
Une première photo la montre à la naissance de Caroline qu’elle tente de consoler maladroitement mais avec tendresse.
Une deuxième photo la montre avec une Caroline espiègle qui affirme sa personnalité face à son frère Albert concentré sur un jouet ou une friandise. Grâce semble tendue, elle a les traits fatigués, mais le journal titre « Loin de l’image glacée de la blonde hitchcockienne qu’elle a si bien su interpréter, Grace, le chignon impeccable, serre tendrement dans ses bras Albert et Caroline. » Le 15 Juin 1959.
IMAGES
Plus récemment une mode, liée à l’évolution de la place du corps dans la société, est de se faire tatouer ensemble lors de la fête des mères, soit le même dessin ou symbole, soit des dessins ou symboles complémentaires scellant la plupart du temps l’adage populaire, normalement dévolu aux couples d’amoureux : je t’ai dans la peau.
IMAGES
Une autre série à succès est représentée par une suite d’articles trouvés dans le magazine Marie-Claire intitulés : Peut-on guérir de sa mère ? Devient-on forcément comme sa mère ? J’ai peur de ressembler à ma mère ; Je suis jalouse de ma fille et enfin, élève-t-on vraiment nos filles comme nos fils ?
IMAGE
Cette rapide revue montre les points de vue des filles sur leur relation à leur mère et des mères et des parents sur leur façon d’être avec leur fille. Ces points de vue sont intéressants car ils illustrent d’une certaine façon l’intemporalité des préoccupations habituelles de la métamorphose que vivent les femmes lorsqu’elles deviennent mères d’une fille et doivent, avec le temps apprendre à s’en séparer.
Conclusion
« L’amour ne suffit pas »
B. Bettelheim, cité dans : Mères-Filles, Une relation à trois ; C. Eliacheff et Nathalie Heinich.
Les conflits dans la relation mère-fille, comme dans toute relation ne sont pas en soi négatifs. Ils peuvent être au service de l’approfondissement, du tissage, du lien tant que leur climat reste celui du respect et de la confiance nécessaire à l’instauration de la pensée et de la parole. Se parler, même si c’est difficile permet le plus souvent de se dégager de l’emprise de l’idéalisation et des répétitions d’agirs inconscient.
Si l’institution d’un tiers dans les relations mères-filles est une condition nécessaire à leur souplesse, cela ne suffit cependant pas. Le respect, tant par la fille que par la mère de la pluralité des relations possibles est indispensable. C’est ce qui permettra à l’une comme à l’autre de traverser les embûches liées aux vicissitudes des différents âges de la vie. Il s’agira alors pour la mère et pour la fille de ne pas se retrouver au centre de la vie de l’autre mais comme un élément de leur vie propre. C’est souvent dans l’après-coup qu’il est possible de se pencher sur les trajectoires de vie et d’en tirer une sorte d’enseignement. Chacun, chacune d’entre nous a traversé ces épreuves, plus ou moins facilement. Devenir une femme, devenir un homme, nécessite du travail, de la persévérance et de l’espoir.
Ces différentes étapes mettent à l’épreuve les degrés de mobilité des interrelations mères-filles.
Devenir femme nécessite le passage de la tradition à la modernité dans le statut de la sexualité ; devenir mère se centre sur la transmission des savoirs, qui se fait par les femmes dans la majorité des cas ; la confrontation à la vieillesse et à la mort est également une « affaire de femmes » dans beaucoup de cas.
Enfin il existe une « spécificité des rapports mère-fille » qui ne peut pas être réduite aux seuls rapports mère-enfant.
Nous avons vu à quel point les interactions précoces étaient fondamentales.
La construction de l’identité passe, pour les filles par une identification primaire à la mère, qui réalise ce qu’on pourrait nommes objet narcissique parfait, les deux protagonistes étant du même sexe. La sortie de cette étape appelée narcissique primaire se fait comme nous le disent certains auteurs, par dédoublement avec une sorte « d’indifférence des sexes ».
Toute la spécificité du travail psychique secondaire qui devra s’effectuer par la fille est relié à ce semblable qui l’a créée. Il s’agit pour elle de construire son sentiment d’identité en s’étayant sur un être semblable dont il lui faut pourtant se séparer, se différencier sans pour autant s’identifier uniquement à l’autre sexe, tout en continuant à en être aimée.
La constitution d’une triade, symboliquement représentée par l’arrivée sur la scène psychique du tiers paternel, qui n’a cessé d’être présent dans l’esprit maternel, soit sous les traits de son propre père, soit sous celui de son amant ou de son mari ou même de sa compagne, facilite le jeu de « l’impératif de différenciation » qui ouvre sur l’altérité.
Ainsi nul ne sait vraiment s’il existe de « bonnes mères et de bonnes filles » ailleurs que dans l’imaginaire idéalisé de l’enfance. Mais tous savent plus ou moins intuitivement, et la clinique le rencontre très fréquemment, que des relations fécondes, souples, solides intégrant tant les dimensions narcissiques que objectales, sont plus fréquemment retrouvées dans les configurations familiales qui n’excluent symboliquement ni le père, ni la fille, ni la mère.
Bibliographie
Bernard Andrieu et Gilles Boëtsch, Dictionnaire du corps, Biblis ;
Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fée (1976) Paris, Pluriel ;
François Buot, Nancy Cunard, Pauvert, 2019 ;
Sophie Carquain, Trois filles et leurs mères, ed. Leduc.s, Charleston, 2018
Carina Coulacoglou, Auteur du FTT, psychologue d’enfants, Université Pantion d’Athènes, 40E Esperou Str., Kifissia, Athènes 14561, Grèce, e-mail : carina@hol.gr, Cairn ;
Caroline Eliacheff et Nathalie Heinich, Mères-Filles, Une relation à trois, Le livre de poche 2019, Albin Michel 2002 ;
S. Freud, Le roman familial des névrosés (1909), dans, Névrose, psychose et perversion, PUF, 1981 ;
A. Green, Le genre neutre, dans Narcissisme de vie narcissisme de mort,
Ed de Minuit, 1983 ;
Claude de la Genardière, Encore un conte ? Le petit chaperon rouge à l’usage des adultes, PU de Nancy, 1993 ;
F. Héritier, Les deux sœurs et leur mère. Anthropologie de l’inceste, Odile Jacob, 1994 ;
R. Kaës et coll., Contes et Divans, Dunod, 1989 ;
P. Lafforgue, Petit poucet deviendra grand. Le travail du conte, Mollat ed., 1995 ;
Le présent de la psychanalyse, Les folies de la norme, Revue de l’APF, n°2, septembre 2019, Puf ;
Marie-Magdeleine Lessana, Entre mère et fille : un ravage, Pluriel, 2020 ;
A.Naouri, Les filles et leur mère, Odile Jacob, 1998 ;
Nouvelle Revue de Psychanalyse, Bisexualité et différence des sexes, N° 7, Printemps, 1973, Gallimard ;
Nouvelle Revue de Psychanalyse, Les mères, N° 45, Printemps 1992, Gallimard ;
Marthe Robert, Roman des origines et origine du roman, Tel Gallimard, 2013 ;
JY Tamet, H. Normand, Le genre inquiet, Le présent dans la psychanalyse APF n°2 septembre 2019 ;
Y. Verdier, Le petit chaperon rouge dans la tradition orale.
Kathleen Winter, Annabel, 10/18 ;
Plan
I- Les contes
I-a Le Petit Chaperon Rouge
I-b Blanche Neige
II- Annabel
III- Madame de Sévigné et sa fille Madame de Grignan
IV- Les Déesses-Mères et les Mères-Etoiles
IV-a Déméter et Perséphone
IV-b Maud et Nancy Cunard
V- Représentations dans l’art et dans la presse des relations mères filles de l’antiquité à nos jours
VI- Conclusion