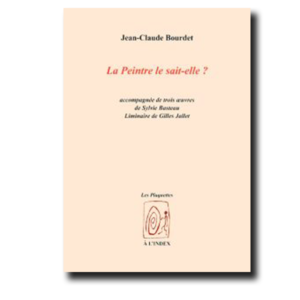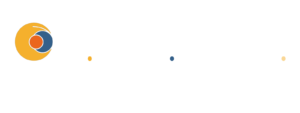Une lecture vagabonde de Graminées Nouvelles étrangères
Revue Littéraire Numéro 3 ; PROMESSE(S) Décembre 2021
Une simplicité sophistiquée revêt l’élégance du format de cette jeune revue qui en est à son troisième numéro après Couple (s) et Evasion (s) les numéros 1 et 2. Il s’agit de réunir sous la bannière de l’association du même nom, de brèves nouvelles étrangères venues de cinq continents, écrites par dix écrivais, traduites par six traducteurs avec le concours de cinq illustrateurs.
L’objet livre attire le regard autant que la main qui caresse la couverture soyeuse avant de l’effeuiller délicatement. Le choix de la couleur dominante, le bleu pour ce numéro, procure immédiatement une sensation de bien-être et d’apaisement. L’esprit curieux par nature, singe agile et présomptueux, après une série de respirations se calme et laisse entrer les formes, les contrastes, il palpe mentalement le contenant comme le ferait un gastéropode prudent avant de s’aventurer dans la multiplicité des caractères que la syntaxe aligne en mots, en phrases en chapitres.
Le lecteur comprendra que les éditrices, jardinières attentives, Eve Vila et Nathalie Tournillon, et leur complice la graphiste Mathilde Dubois, se sont engagée dans une passionnante aventure qui nous entraine aux quatre coins du monde.
La première étape du voyage nous fait découvrir une Asie dont le tableau de Sylvie Bello tente d’adoucir la modernité tentaculaire.
Les rites ancestraux sont malmenés, réduits, asservis, l’auteur de la première nouvelle, traduite par Coraline Jortay, Ho Sok Fong, résiste à cette colonisation en inventant un personnage subversif qui se retrouve coincé derrière un mur de béton. Le mur est le symbole universel de l’oppression – politique, physique ou mécanique – d’une société en plein bouleversement anthropocénique. La solution géniale de l’auteur est une métamorphose du personnage en héroïne qui disparait progressivement de la scène et se retrouve, dans le récit de papier, se faufilant, invisible entre les poubelles de l’histoire.
La deuxième nouvelle, Ma fille et la cigarette, de Murat Ozyasar, traduite par Sylvain Cavaillès est un pur enchantement. J’ai été ému, et ému et j’ai envié cet auteur pour telle expression, telle tournure de phrase. Quel plaisir de sentit l’instant saisit au tournant d’une traduction au cordeau comme on dit dans le bâtiment d’une mesure très précise. Les répétitions confèrent à l’écrit le rythme de l’enfance, lorsqu’elle cherche à affirmer une vérité toute crue, jusque chez le futur père qui répète, se souvenant du jour de la naissance de sa fille : Jusqu’à maintenant. Jusqu’à maintenant. Pourtant, maintenant, ce n’était pas le monde, ni l’eau, mais moi-même qui étais troublé.
Et plus tard dans la lecture : papa, ne me réponds pas de question ! et encore : papa, replaisis-toi !
Et je ne me lasserais pas de lire-re-lire ces mots, que j’aimerais entendre de la voix qui les écrit dans toutes les langues qui bleuissent les âmes en-en vrai.
Merci Murat Ozyasar !
Ma lecture se poursuit et s’écrira demain ou après-demain.
Dimanche, 20 mars 2021
Premier jour d’un printemps gris, l’Europe saigne à Marioupol.
Allons du côté d’une Océanie que le pastel d’Inbar Heller Algazi dessine. L’écoute du souffle des vents marins et du glissement des lourds nuages bleus nous avertissent que nous entrons dans une zone de turbulences.
Attention, nouvelle de Catherine Childgey, traduite par Eve Villa nous précipite dans les souvenirs d’enfance du narrateur. Nous le suivons dans le territoire aride, dangereux, sec et brûlant du bush : il faisait un soleil de fournaise… Les paysages, les odeurs, les vies s’égrènent dans une syntaxe parfaite. Nous nous trouvons précipités dans une suite d’illusions et de désillusions qui deviennent les fils d’ariane du récit que le lecteur découvrira la matérialité narrative. Le tour de force de l’auteur est de nous entrainer, sur le fond d’une contrée inconnue, dans l’universalité des relations humaines, parentales, amicales, professionnelles. Ici où là-bas, et on devrait pourtant le savoir, les mères ont un amour abusif et narcissique pour leur rejeton, les amie(s) sont jalou(x)ses, l’image dévore la pensée, le soleil manque de modestie.
Je pensais qu’avec Nicolas Kurkovitch entrant dans Le séjour paisible j’allais dériver, suivre les alizés de rêveries maritimes, mais l’auteur en une phrase suscite le respect et l’attention la plus soutenue possible, comme si la surface calme de la mer pouvait à tout instant nous précipiter dans les courants et des tourbillons émotionnels et sensoriels irrépressibles vers les abysses les plus insondables.
On n’entre pas de façon nonchalante sur un territoire qui n’est pas le sien.
Cet avertissement opéra comme une sorte d’autorisation de survoler, presque sans y poser l’œil le récit trop puissant de Nicolas Kurkovitch
Alors
ne pas plonger dans les eaux noires du fleuve nocturne
rester en surface attendre
l’œil s’habitue l’ombre s’apaise
alors alors seulement s’assoir
entrer dans le courant des mots
Ensuite peut-être
entrer dans le champ
fouler le vert frais de l’herbe
laisser la trace d’un pied nu
pour enfin seulement oser
poser un œil sur les lignes du destin
…
Suivre Tarou jusque dans sa maison s’assoir prés du foyer, le temps d’une histoire, sous le haut toit de feuilles tressées, et, avec lui, ressentir la présence du monde au fond de l’étroite vallée.
Nous étions là, nous vivions là, un poème pour changer notre présence au monde.
C’est ce qui nous restera quand toutes les vallées du monde seront soumises à un « vaste projet de constructions sociales. »
la nuit qu’est ce rien
ou trop d’espace ou encore
trop de temps rien
Lundi 28 mars.
Il m’aura fallu plusieurs jours pour oser m’aventurer dans la forêt bleue que la peinture acrylique de Béatrice Bandiera propose comme porte d’entrée du continent européen. Le premier pas est rude en ces temps troublés par la guerre d’annihilation, comme la qualifie André Markowicz, que Vladimir Poutine mène en Ukraine. Rude et glaciale. La langue d’Annika Norlin, traduite par Isabelle Chéreau, est tranchante. Cette langue m’a faite tomber dans une ruralité brutale que le solitaire affronte avec un tord-boyau mortel. Je dois avouer que j’ai – après un détour par la consultation d’une liste d’auteurs suédois qui m’étaient plus familiers, Ingmar Bergman, Henning Mankell mais aussi Astrid Lindgren créatrice de Fifi Brindacier, Nelly Sachs fidèle amie de Paul Celan – enfin, pu déchiffrer l’âme de la nouvelle. Une familiarité s’installe avec les personnages – pêcheurs, petits entrepreneurs, certains très portés sur la boisson, souvent seuls et désœuvrés – qui entrent en résonnance avec des figures de mon enfance rurale. Lundi 28 mars.
Le sujet de la nouvelle est la solitude, réelle, imaginaire elle crée ses propres remèdes.
J’ai l’impression d’avoir connu Olof « qui n’avait jamais quitté son village et qui voyageait sans avoir besoin d’un passeport ». Flanqué d’une bouteille de gnole, j’ai cru reconnaitre cet homme mort le « sourire aux lèvres ». La pute balte, titre du récit, soulage brièvement la solitude du père Fogdo, avant de repartir vers son destin.
Il en est ainsi des rêves, nécessaires, résolutifs, mais passagers clandestins.
Lundi 4 avril.
Les poissons ne ferment pas les yeux / Il pesci non chiudono gli occhi,
Tenter l’expérience qu’Erri de Luca partage avec nous dans ce petit livre, lu il y a quelques années dans une traduction de Danièle Valin.
Comment dire : peut-être que la voix de Cyril Laumonier, qui a lu le début de la nouvelle de Marco Ursano, Le plongeur, deuxième incursion sur le continent Europe, dans une cave de l’ile saint louis un soir de Mars 2022 est restée gravée dans ma mémoire.
Peut-être ai-je été comme les vieux pêcheurs de Forte dei Marmi, étonné et perplexe par cette façon inattendue de nous entrainer dans une mystérieuse mythologie locale. Au fond, les défis sportifs que le personnage affronte sont la sources d’autres défis que la modernité impose à son tour. Une sorte d’emballement du récit se justifie par le maillages d’alliances entre les protagonistes, alliances opportunistes pour certains, véritable dévotion pour d’autres. La nature humaine sauvage, profondément narrative de l’histoire nous plonge dans les abysses d’un univers familier avec les dieux. L’amour, destin inévitable du héros l’entraine dans un hésitation salutaire, déni adolescent d’un état que les solstices préfigurent en vain. L’envolée des élancés plongeurs, évanescence d’une âme sacrée, fonctionne comme une poésie mythologique, sensuelle et altière. Les mots s’absentent comme le héros de la nouvelle, peut-être seront-t-ils de nouveau au rendez-vous en octobre.
Mercredi 6 avril.
I seek to cure what’s deep inside, frightened of this thing that I’ve become ; Africa, TOTO IV
Elle était notre sœur et notre amie, mais depuis l’époque où on était des totos, Meri n’était pas comme nous.
Meri aurait-elle pu penser, comme Davis F Paich ou Jeffrey T Porcaro l’écrivent :
j’ai peur de cette chose que je suis devenue ? Je ne crois pas.
Makena Onjerika, et Eve Vila qui traduit Fanta cassis nous précipitent sans ménagement dans une langue qui n’est pas seulement étrangère, c’est une mécanique implacable, un processus que Freud a très bien traduit dans un petit essai intitulé L’inquiétante étrangeté. Le procédé est redoutable : anonymat d’une narratrice objective, détails anecdotiques, focus sur un fait divers dont le titre serait resté entr’aperçu dans un fil d’actualité chargé : disparition d’une travailleuse du sexe dans les bas-fonds de Nairobi.
Mais ce que Freud a magistralement démontré c’est que ce qui suscite l’angoisse n’est pas l’étranger mais au contraire l’intime refoulé. C’est là le tour de force de l’auteure. Sous couvert d’un exotisme équatorial, Makena Onjerika mobilise subtilement nos peurs en nous présentant la force brutale d’une existence misérable. L’effacement de toute compassion n’a comme source que la nécessité de la survie. Makena Onjerika reprend le récit là où, dans le froid glacial de l’Europe de l’Est, Julio Cortazar termine une autre nouvelle : La lointaine. Sur un pont glacial battu par un terrible vent d’Est, le narrateur en croisant une mendiante, constate, avec toute l’horreur dont l’auteur sait charger ses personnages, qu’il a changé de corps et se trouve désormais à regarder de ses yeux secs s’éloigner l’élégante silhouette de la personne qu’il était l’instant d’avant. J’ai sur ma loggia une plante qui repousse chaque printemps, je ne saurais en dire l’espèce mais elle a cette étonnante capacité de survie qu’acquièrent certains êtres dont les histoires égrènent nos mémoires hantées par la culpabilité des nantis.
Le continent Africain nous offre habituellement une possibilité de rédemption que le récit ne propose même pas. Les bons samaritains ne suffisent pas à sauver l’âme simple de Meri destinée à une errance éternelle.
L’horreur, appelle le silence,
alors, s’allonger sous un escalier défoncé, alors
se recroqueviller,
attendre que la douleur s’estompe,
siroter un Fanta cassis
redevenir un toto et chantonner en Ingrish :
Meri hada ritro ramp, ritro ramp, ritro ramp
Vendredi 8 avril.
Le tableau :Rotring,de Julien Martinière, ouvre le continent Afrique dont je viens d’explorer la première nouvelle Fanta Cassis. Il représente au premier plan une femme endormie symbole de la terre mère. L’illustrateur installe en entre deux, avec en arrière-plan des forêts dévastées par l’exploitation industrielle, un no man’s land dans lequel les enfants travaillent une terre chaotique d’où certains extraient des gros diamants.
La scénographie politique du stéréotype d’une Afrique soumise à ses exploitants ne se retrouve pas dans la deuxième nouvelle : La fille sur l’affiche de la cabine d’essayage, de Jackee Budesta Batanda traduite de l’anglais (Ouganda) par Eve Villa.
Le texte est construit sur une dramaturgie introductive : une amie perdue de vue depuis plusieurs années envoie un mail de détresse. La destinatrice du message, qui est la narratrice, se remémore sa dernière rencontre avec son amie à Johannesburg. Rencontre qui devait sceller la rupture de l’amitié estudiantine dans une sorte de happening dont la photo dans la cabine d’essayage devenait le symbole.
Entre enthousiasme collégien et badinage superficiel, les protagonistes dessinent progressivement une histoire humaine universelle. L’arrivée d’un tiers masculin dans la relation entre deux filles est souvent catastrophique pour l’une d’elle. La suite coule de source, l’image mentale construite par Nalyaaka d’une Trudy attentionnée, fidèle, ne colle plus avec « la fille sur la photo ». Quant au gars, il ne plait pas à l’amie Ougandaise qui ne le cache pas à Trudy. Mais l’aveuglement, la solitude et l’amour sont bien plus puissants qu’un lien d’amitié effiloché par l’éloignement et le temps. Trudy rejette Nalyaaka qui revient dans sa vie personnelle, son travail, ses engagements humanitaires et perd de vue la blondeur du mannequin, seule blanche dans le tableau, qui vantait la qualité de la vie à Jozi.
Il en est ainsi de l’amitié, construite dans la ferveur de l’adolescence elle ne survit pas toujours aux méandres de la déraison.
Cependant, et c’est là la question, va-t-elle renaitre de ses cendres ? Le récit laisse le lecteur en décider.
Une page plus loin, un océan franchit nous nous retrouvons face à un décor religieux-kitsch qui pourrait orner l’autel d’une de ces nouvelles religions dont le nouveau monde qui peuple l’Amérique est friand. Claire Gaudriot a su tirer de ses crayons le collage symbolique d’un continent violent empreint de dieux terribles, tout puissants, humains, naturels ou surnaturels.
Ensuite-ensuite : dans la « plainte grinçante et morne d’un perpétuel guitarrón » les versets du « lévitique.moïse.tapia.houiqui » de Miguel Tapia, traduits par Gersende Camenen,égrènent leur glaçantes commandes d’un pacte de sang. Le Mexique en serait le théâtre, avec le Seigneur des seigneurs dans le rôle-titre, et Moïse et Aaron comme chefs de factions en quête de protecteur. Le moyen âge au présent d’un mode narratif biblique qui sacralise le lien avec un monde ancien. Un de ces mondes qui peuplent nos imaginaires infantiles avec des méchants-méchants très- très méchants qui font très-très peur et sans signe aucun-aucun d’un quelconque justicier blanc, ou rouge, ou jaune, ou noir qui viendrait réparer la « fixité de cette très haute et torride lumière ».
Je ne saurais certainement pas si La dernière femme sur terre, de Carleigh Baker, traduite par Eve Vila, dont le thème est la fin de quelque chose et l’attente d’autre chose, d’un nouveau récit, promesse certainement d’un prochain numéro de Graminées.
L’auteure nous entraine dans une aventure immobile comme seuls les reclus volontaires savent en produire. Les sens sont en alerte mais l’esprit émoussés par l’apathie du personnage clinophile, addict à un jeu vidéo post apocalyptique. Elle parait aussi perdue que la dernière femme qu’elle semble devenir par moment. Elle se sent épiée comme elle-même qui épie et suit pas à pas les élans survivalistes du personnage de son jeu vidéo tout en conversant avec un ancien ami à l’autre bout de la planète.
En guise de conclusion.
Toutes les nouvelles sont liées par une promesse, tous les personnages attendent quelque chose, un ami, une reconnaissance, un enfant, une protection, un avenir meilleur. Tous se retrouvent coincés dans cet entre-deux que Chronos dévore sans état d’âme, terreur sans nom et pourtant n’attendant rien.
Alors, alors Gaïa se rebelle et tient ses promesses.